Narcotrafic : pourquoi la France ne parvient pas à stopper son expansion
Les nouveaux modes de distribution des drogues, les manques de contrôle des flux de marchandises et une méconnaissance des réseaux criminels peuvent expliquer les difficultés à endiguer les trafics.

Le rapport du Sénat sur l’« impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier » donnera lieu à une proposition de loi, ce mercredi 22 janvier. Le ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau, et le ministre de la justice, Gérald Darmanin, multiplient les annonces chocs sur ce sujet. Pourtant, après des années de montée en puissance du dispositif juridique et policier, le nombre de victimes de règlements de comptes et les tonnes de marchandises importées sur le territoire ne diminuent pas. Comment l’expliquer ? Comment y remédier ?
Règlements de comptes, opérations places nettes, saisies spectaculaires, annonce d’un nouveau projet de loi pour mieux lutter contre le narcotrafic, l’actualité récente rend évidente l’expansion de ce dernier dans l’ensemble du territoire français.
Un Plan national de lutte contre les stupéfiants a été mis en œuvre en 2019. Mais la Commission sénatoriale d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France, dont les conclusions ont été rendues en mai 2024, dresse un bilan d’échec des récentes politiques antidrogues. Cela semble particulièrement patent en matière de lutte contre les trafics.
Un arsenal pénal visant à sanctionner les chefs de groupes criminels impliqués dans le narcotrafic, la production et/ou la fabrication illicite de stupéfiants, l’exportation et/ou l’importation illicites de stupéfiants, ainsi que le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants, mais, à en croire les chiffres fournis par le ministère de la justice, en 2020, les procédures pour infractions à la législation sur les stupéfiants concernaient pour l’essentiel l’usage, et non le trafic de stupéfiants.
Comment expliquer ce décalage entre dispositifs existants et résultats obtenus ? Le déploiement de nouveaux modes de distribution des substances prohibées, la persistance de vulnérabilités notamment portuaires et un certain nombre d’illusions sur le fonctionnement du crime organisé constituent quelques éléments de réponse.
À lire aussi : La France au cœur des trafics de drogue : un regard géopolitique
Une accessibilité accrue aux stupéfiants
Malgré un arsenal parmi les plus répressifs d’Europe, la France est depuis des années l’un des pays les plus gros consommateurs de stupéfiants. Stéphanie Cherbonnier, ancienne directrice de l’Ofast (Office anti-stupéfiants, l’agence chargée de coordonner la lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire français), estimait en 2022 à 900 000 les consommateurs quotidiens de cannabis et à 600 000 les personnes ayant touché à la cocaïne en France. On pourrait considérer que la demande crée l’offre mais cela serait se méprendre sur la spécificité de substances addictives. En réalité, l’offre croissante s’écoule via des stratégies marketing élaborées.
La cocaïne, en particulier, est devenue extrêmement disponible, la culture de la coca en Amérique latine ayant atteint un pic en 2023. Résultat : des quantités de stupéfiants importantes à écouler dans un contexte de saturation du marché américain.
L’Europe et la France sont devenues une cible pour des narcotrafiquants en mesure de proposer une drogue très pure et à des prix moindres que par le passé. Auparavant considérée comme la drogue des élites, la cocaïne s’est démocratisée.
Les réseaux criminels ont tiré des leçons du confinement sanitaire de 2020. Contraints de développer des modes alternatifs au traditionnel point de deal pour approvisionner le consommateur final, ils se sont tournés vers les réseaux sociaux et les livraisons à domicile. Initialement artisanales, ces pratiques se sont littéralement professionnalisées.
Elles ont permis de toucher de nouveaux usagers d’un point de vue géographique et social tout en jouant sur l’addiction. Là où le fait de se déplacer vers un point de deal avec les risques inhérents d’interpellation, d’identification, d’agression, constituaient une barrière pour certains, la livraison via les applications téléphoniques et les réseaux sociaux désinhibe certaines personnes et rapproche les stupéfiants des consommateurs potentiels.
Cette « uberisation » s’appuie aussi sur un marketing très offensif visant à entretenir la pulsion de consommation : relances par SMS, programmes de fidélisation, offres promotionnelles, échantillons de nouveaux produits à tester renforcent une consommation déjà captive par nature. En parallèle, ces circuits invisibilisent en partie le trafic, rendant les réseaux plus flexibles, multiples et difficiles à cerner par les forces de l’ordre.
Le manque de contrôle des flux de marchandises
Avant d’atteindre le consommateur final, les stupéfiants parcourent généralement des routes internationales. La matière première est souvent géographiquement très localisée : la coca ne peut être cultivée que sur le plateau andin, le pavot pour l’opium et l’héroïne vient principalement d’Asie du Sud-est, les plantations de cannabis se diffusent mais une part non marginale provient du Maghreb. Même les produits chimiques servant à fabriquer les drogues de synthèse ont des bassins de production localisés, notamment en Chine. Le trafic de stupéfiants se greffe sur le commerce international et en exploite les vulnérabilités.
La grande majorité des flux internationaux passe par les voies maritimes. Les ports sont donc en première ligne. Là où les opérations place nette rétablissent momentanément l’ordre public mais ne permettent de saisir que des quantités modestes de stupéfiants, les quantités saisies dans les ports et sur les grands axes routiers sont massives. Or, dans les ports européens, seulement 2 % des marchandises font l’objet d’un contrôle. Cela offre une probabilité élevée de faire circuler des marchandises illégales sans interception.
Ce manque de contrôle sur les flux de marchandises est le résultat d’un choix politique, celui de privilégier l’efficience économique au détriment de la sécurité. Le libéralisme recherche la plus grande fluidité possible dans la circulation des marchandises. Cette rapidité est pensée comme un avantage concurrentiel. Dans cette logique, le contrôle, notamment douanier, constitue un grain de sable venant ralentir la machine. Pourtant, mieux contrôler les portes d’entrée sur notre territoire comme les ports et les hubs logistiques est un impératif pour lutter efficacement contre les flux de marchandises illégales (stupéfiants, mais aussi contrefaçons, armes, espèces protégées…).
L’« illusion de savoir »
Combattre le narcotrafic impose aussi de sortir de l’« illusion de savoir » qui caractérise trop souvent les décideurs politiques. Le monde criminel est dynamique, il évolue en fonction des opportunités économiques (avec de nouveaux trafics), technologiques (via les messageries cryptées par exemple) et juridiques (en contournant la législation sur les substances interdites via l’invention permanente de nouvelles drogues de synthèse).
Il faut être humble et accepter que ce que l’on savait ou croyait savoir sur les réseaux criminels un jour n’est plus valable le lendemain. Cette démarche doit s’appuyer sur un effort de renseignement criminel, ce qui suppose en amont une formation notamment en criminologie, discipline pour l’heure non reconnue en France, à la différence des pays voisins comme l’Italie, le Royaume-Uni ou la Suisse. L’expansion de la criminalité organisée dans son ensemble mérite que des chercheurs se dédient à l’étude de la nature, des causes, des conséquences et des moyens de lutter contre ce phénomène.
Ces insuffisances se révèlent dans l’utilisation récurrente, par des politiques, de termes erronés tels que monopole, pieuvre ou narcomafia pour évoquer le narcotrafic en France. Le trafic de stupéfiants à l’heure actuelle repose sur une myriade d’organisations criminelles plus ou moins grandes et coopérant bien plus souvent que ne le montrent les règlements de compte. Il n’y a donc pas une pieuvre à décapiter. Le terme mafia désigne, lui, une réalité criminelle bien précise allant bien au-delà du trafic de stupéfiants et développant dès sa naissance des activités tant dans la sphère légale qu’illégale avec une emprise sur l’économie, la politique et la société. Réduire la notion de mafia à celle du trafic de stupéfiants est donc une erreur de diagnostic.
Comprendre l’extrême diversité des organisations criminelles, les identifier, les nommer, comprendre leurs interactions et surtout leur hiérarchisation est urgent pour une action répressive ciblant les acteurs de premier plan et non les petites mains. Pour cela, un changement de regard s’impose : ne pas se focaliser sur le narcotrafic et prendre en compte la globalité de la menace criminelle d’acteurs dont beaucoup ont développé une polyactivité criminelle impliquant, par exemple, du trafic d’armes, de la traite des êtres humains, de la criminalité environnementale ou autre en fonction des opportunités économiques et des relations entretenues avec d’autres organisations criminelles.![]()
Clotilde Champeyrache ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.








![[SATIRE À VUE] Emmanuel Macron poursuit sa tournée des bar-tabac](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/macron-cafe-grok-616x347.jpg?#)

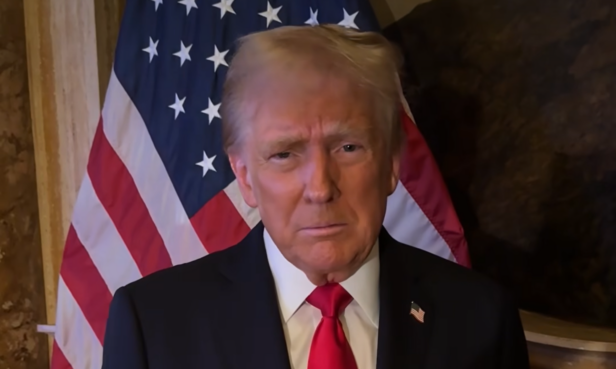





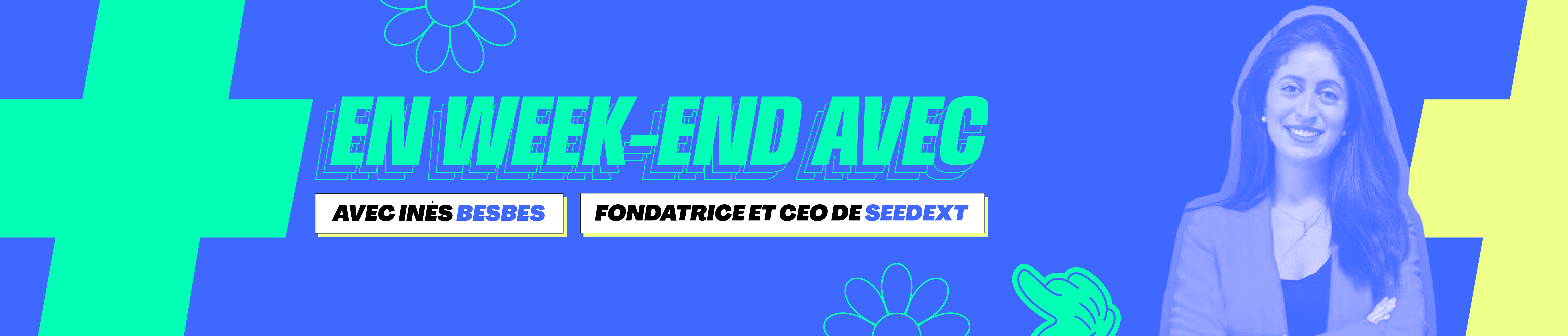
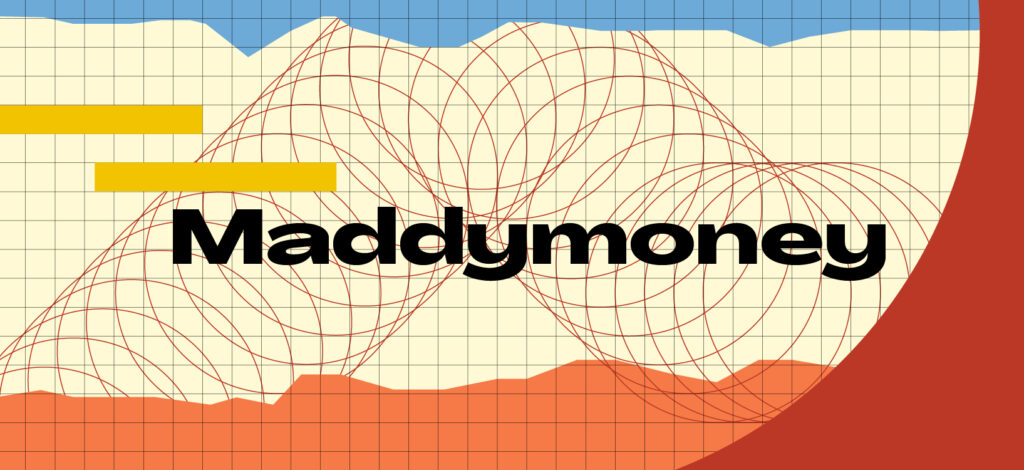



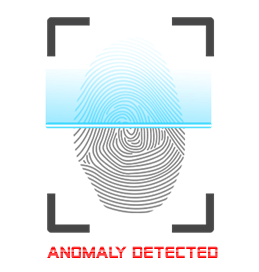








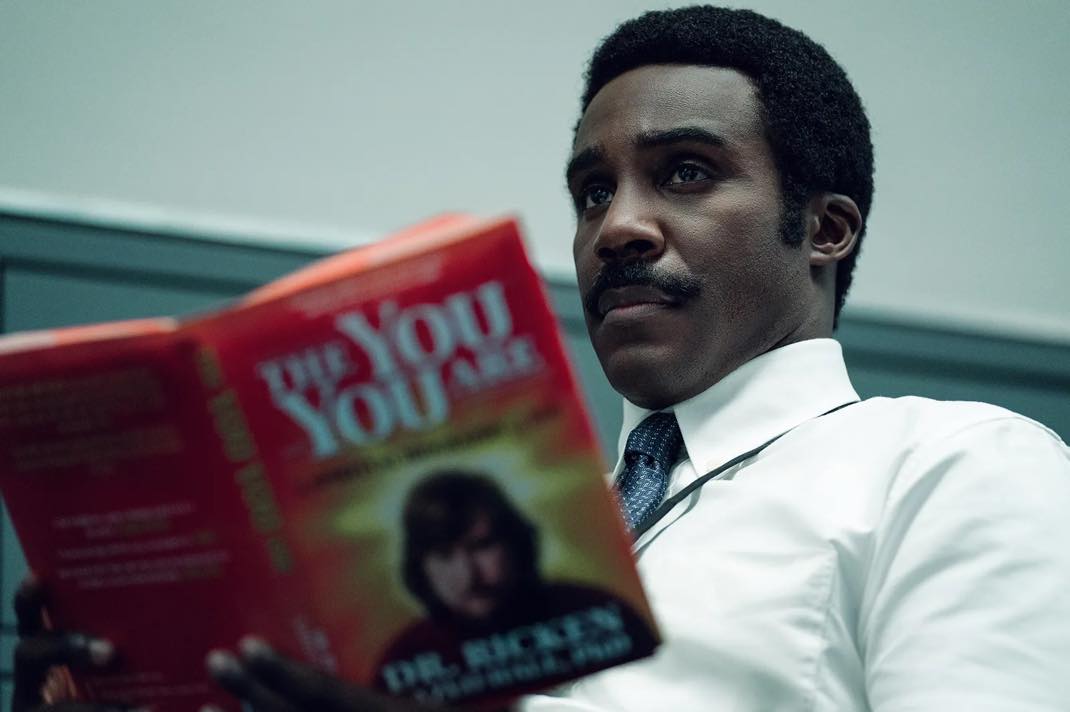
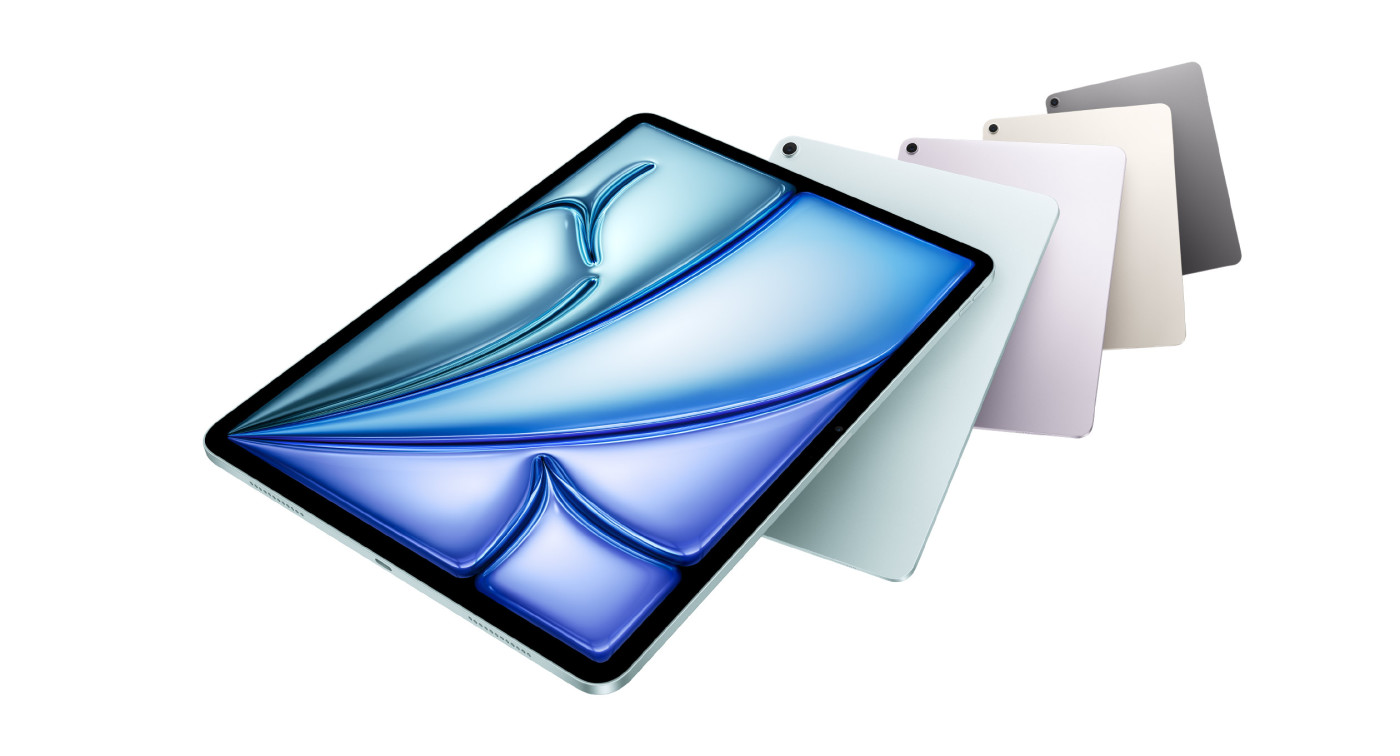




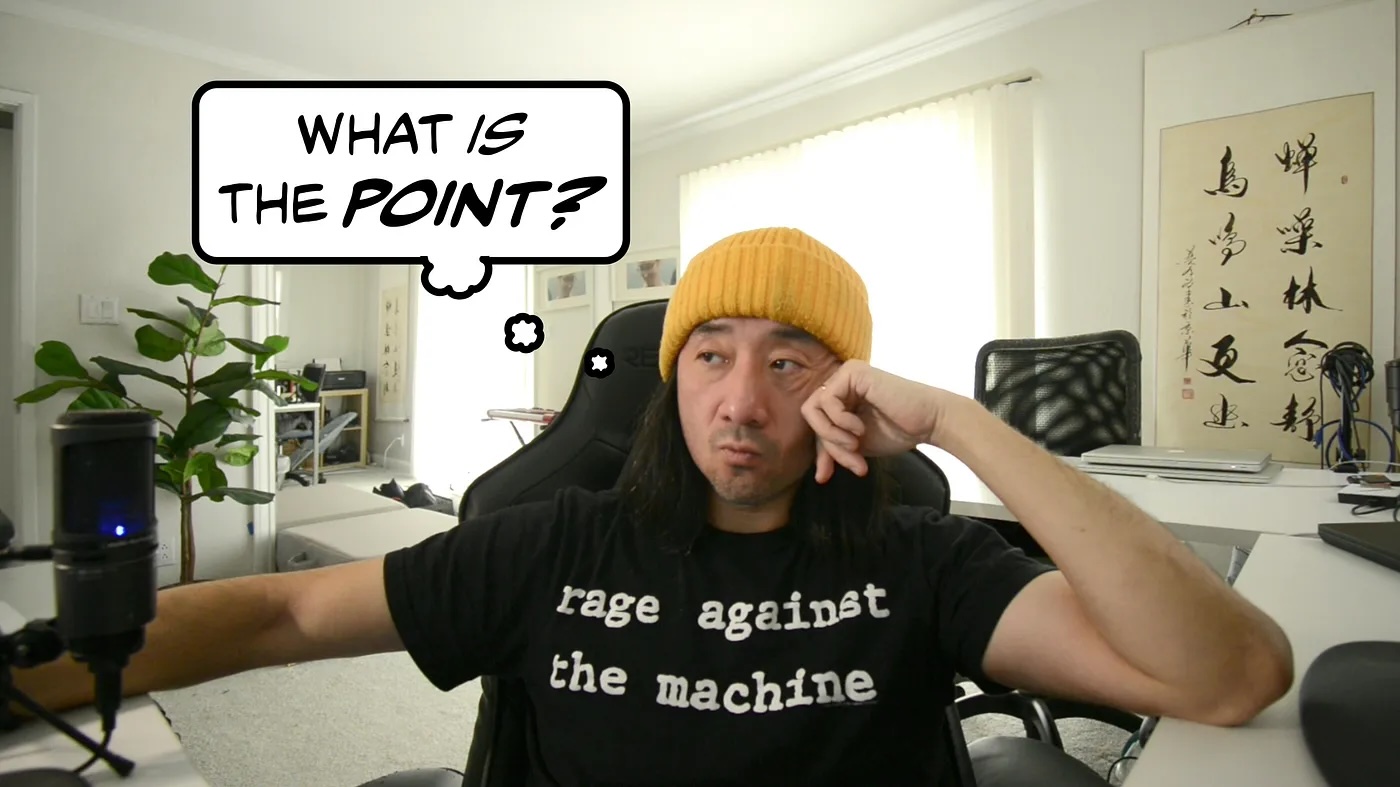
















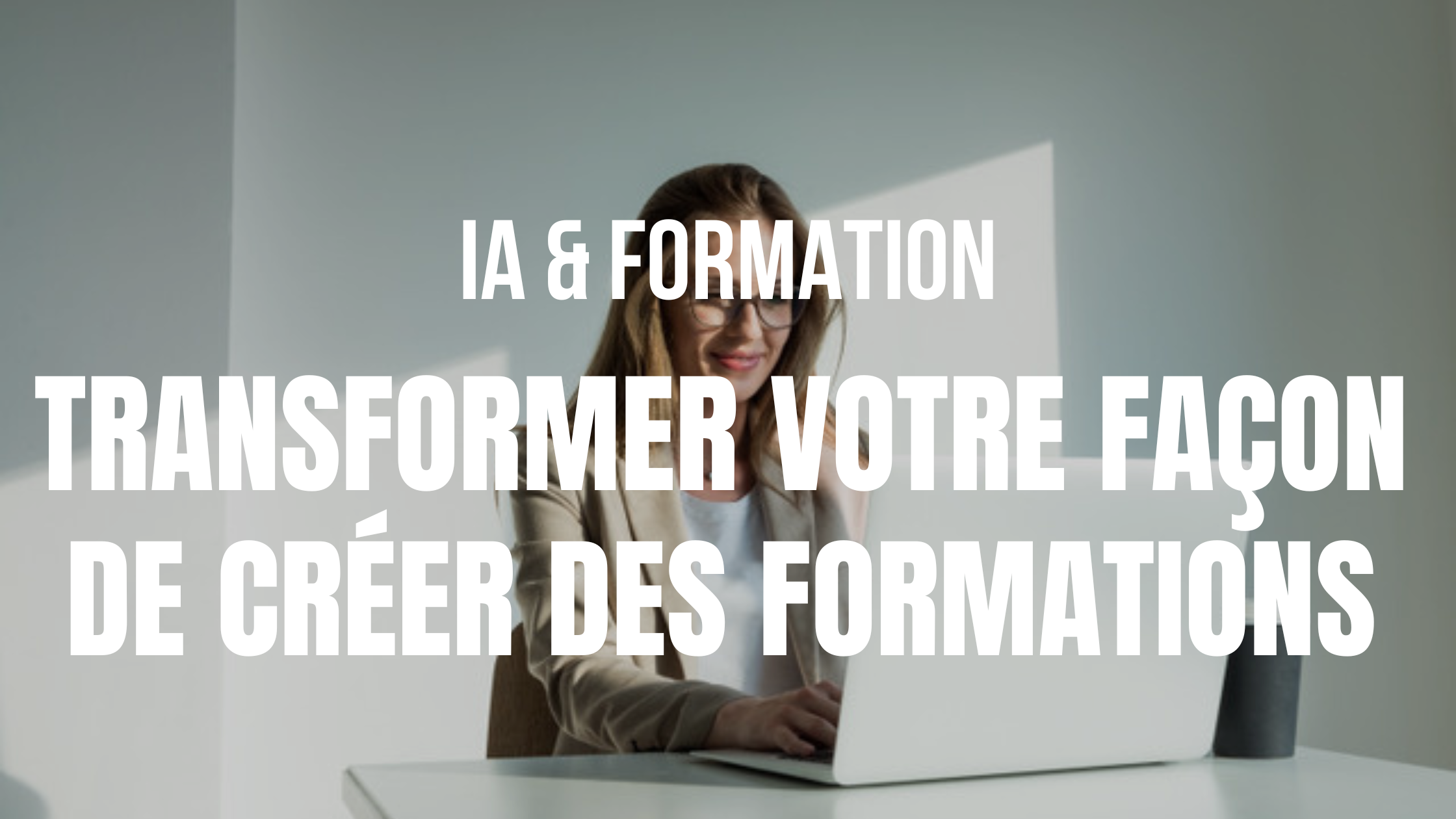

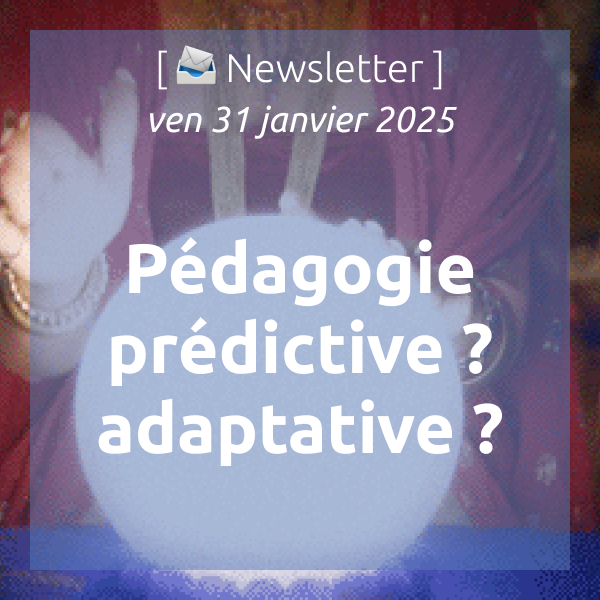



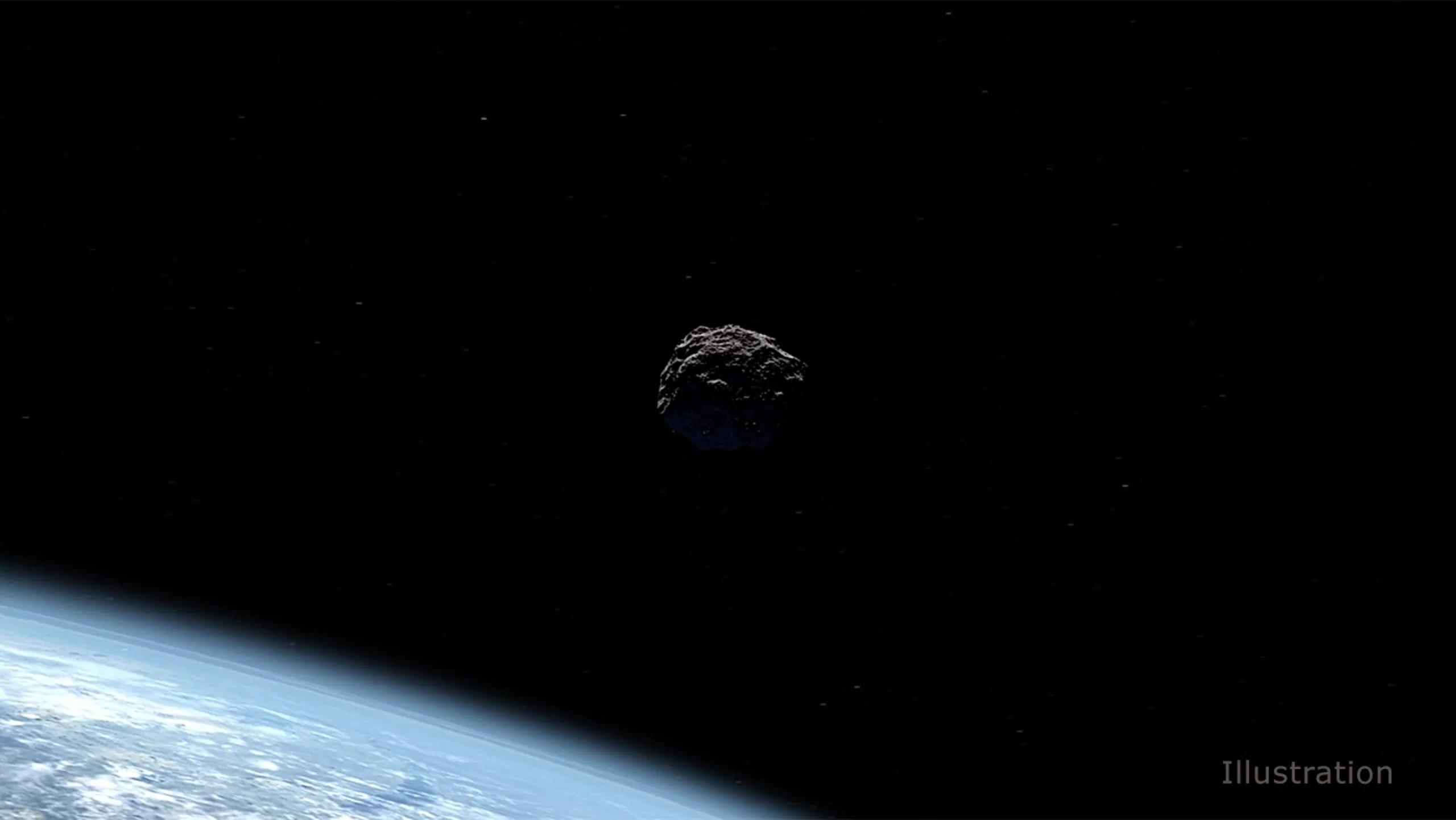


![« Ce n’est pas parce qu’on reçoit qu’on adhère » : Raphaël Schellenberger, député [3/3]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_3080.jpg)


















