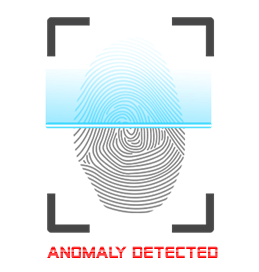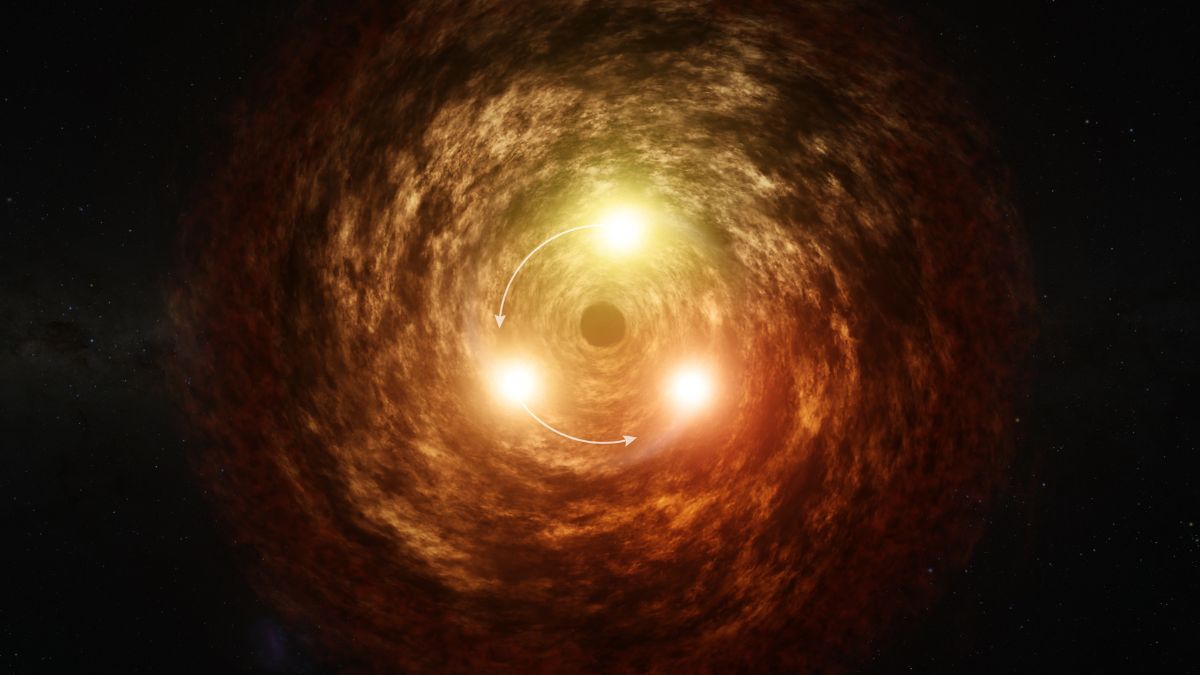Comment la géographie scolaire construit un récit territorial
Souvent abordée par les collégiens et les lycéens comme une matière neutre, annexe de l’histoire, la géographie concentre en réalité un certain nombre d’enjeux citoyens.

Souvent abordée par les collégiens et les lycéens comme une matière neutre, annexe de l’histoire, la géographie concentre beaucoup plus d’enjeux qu’on ne le dit souvent. Marquée par des discours idéologiques, elle participe aussi d’une éducation citoyenne.
Si la géographie est souvent vue par les collégiens et les lycéens comme une matière annexe à l’histoire, elle participe tout autant de leur éducation citoyenne et se révèle aussi marquée par des discours idéologiques.
Le « roman national » construit par l’histoire scolaire est l’objet de débats animés qui contrastent avec le silence assourdissant entourant les programmes de géographie. Autant que l’histoire, ces derniers participent à l’éducation à la citoyenneté. Cependant, leur dimension idéologique est transparente, passée sous silence. Et l’on tend à considérer la géographie comme la petite sœur de l’histoire, ou simplement la matière qui en donne le contexte.
C’est l’un des clichés que propose de déconstruire l’ouvrage Neuf idées reçues sur l’enseignement de la géographie publié en octobre 2024. En effet, le roman national a un équivalent géographique, le « récit territorial ».
Rappelons que la généralisation de l’histoire-géographie à l’école primaire après 1871 visait à développer les capacités de raisonnement des élèves, à leur faire découvrir et aimer le territoire-patrie mais aussi à former de futurs soldats capables de lire des cartes.
D’abord centré sur la richesse et la singularité de chaque région française et la puissance coloniale, le récit territorial a profondément évolué au cours du XXe siècle tout en continuant à mettre en scène un monde fantasmé. À l’origine, il s’est construit autour de l’idée d’une construction continue du territoire, délimité par ses frontières « naturelles », construction organisée par un État aménageur omnipotent et disposant d’une « vision » de son organisation. Cette construction est aussi marquée par de grands épisodes démontrant la volonté et la puissance de l’État : les places fortes de Vauban, le réseau de transport en étoile, les métropoles d’équilibre, la valorisation du littoral languedocien.
Si le récit territorial est émaillé de grands programmes d’aménagement, la décentralisation aurait pu en marquer la fin en multipliant les acteurs spatiaux mais ce récit se poursuit en fait à différentes échelles.
Un récit marqué par le néolibéralisme
La géographie scolaire met en lumière les espaces bien insérés dans la mondialisation et continue de partager le monde en deux, les Nords et les Suds, alors même que cette limite est remise en cause au sein de la géographie savante.
Parmi les territoires valorisés figurent au premier rang ceux qui sortent gagnants de la mondialisation, notamment les grandes métropoles mondiales bien insérées dans les réseaux économiques et financiers : Paris, Londres, New-York, etc. À une échelle plus grande, ce sont encore les espaces productifs compétitifs comme les clusters, les technopoles, les pôles d’excellence, etc. À l’échelle française, cela conduit à une surreprésentation des régions métropolitaines et des régions frontalières au détriment du reste du territoire national.
Empreint d’un discours productiviste et néolibéral, ce récit s’appuyant sur des territoires sélectionnés à l’aune de l’économie et de la mondialisation remplace le récit territorial des XIXe et XXe siècles, davantage marqué par le colonialisme. Il montre la compétitivité de la France face à des puissances plus médiatisées, telles que les États-Unis ou la Chine. Ce récit est donc fortement politisé et idéologique sans que cela soit clairement perçu par les élèves, habitués à un enseignement consensuel, présentant des résultats non contestables.
Une mise en scène de la puissance publique
Les espaces moins bien insérés dans la mondialisation, tels que les territoires ultramarins ou les espaces de faible densité, ne sont pas complètement absents des programmes. Mais ils font l’objet d’un récit spécifique et sont abordés sous l’angle de leurs atouts, qui seraient donc à valoriser pour accéder eux aussi au statut de territoires gagnants.
Dans les espaces ruraux, soumis à la déprise agricole et à la décroissance démographique, sont mis en avant le développement de nouvelles activités comme l’agrotourisme, l’agriculture bio ou encore la valorisation des terroirs avec des produits d’appellation d’origine contrôlée (AOP). L’enclavement, les inégalités socio-économiques ou encore le retrait des services publics sont peu développés la plupart du temps.
Les territoires ultramarins connaissent un traitement proche. La géographie scolaire met en valeur leurs atouts touristiques, leurs paysages, et éventuellement la fragilité de leur milieu. En revanche, ne sont pas ou peu abordées la faible insertion de ces régions dans leur aire régionale, les discontinuités marquantes entre les Outre-mer et la métropole, les inégalités socio-économiques au sein de ces territoires et leurs problématiques spécifiques comme les enjeux des migrations, par exemple en Guyane française ou à Mayotte. Les luttes sociales qui ont traversé les Outre-mers ces dernières années ne sont pas non plus abordées. Les ZAD, telles Notre-Dame-des-Landes, font également partie de ces territoires invisibilisés.
Les espaces peu couverts par la géographie scolaire sont donc aussi marqués par un discours néolibéral qui participe à la promotion de ces territoires. Paradoxalement, ce discours se double d’une mise en scène de la puissance publique, à travers des aménagements comme la route du littoral à la Réunion, présentée comme un moyen de favoriser les mobilités insulaires. Or, l’enclavement de l’intérieur de l’île est omis et la saturation de la route insulaire n’est pas abordée. La mise en scène de l’État comme sauveur des territoires est une forme d’incarnation de la solidarité républicaine, une forme renouvelée de l’État-providence.
Le récit territorial participe à une mise en ordre du monde au prisme de deux idéologies antagonistes : le néolibéralisme et l’État-providence. Il contribue ainsi à une éducation à une citoyenneté d’adhésion, sachant que la « citoyenneté d’adhésion repose sur un processus de construction de l’unité par la transcendance des identités particulières ».
Le récit territorial, levier d’éducation à la citoyenneté ?
Le roman national et le récit territorial s’inscrivent dans la perspective d’une éducation à la citoyenneté qui vise à transmettre une culture commune et des valeurs partagées. Le récit territorial met ainsi en valeur un État aménageur soucieux d’égalité entre les citoyens, en oubliant de mentionner les politiques publiques qui conduisent à la fermeture de services essentiels tels que des maternités, au nom de la rentabilité. Il valorise un État soucieux des libertés, mais qui supprime les filières d’enseignement professionnel ne correspondant pas aux espaces productifs présents.
[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]
L’enseignement de la géographie comme celui de l’histoire vise aussi à développer l’esprit critique des élèves, ce qui peut les amener à questionner, voire à remettre en cause le récit territorial, s’inscrivant alors dans une citoyenneté d’engagement. Cette autre forme d’éducation à la citoyenneté
L’éducation à la citoyenneté d’engagement et celle à la citoyenneté d’adhésion coexistent au sein de l’enseignement de la géographie et de l’histoire. Cependant, les choix effectués dans les manuels vont assez peu dans le sens de la citoyenneté d’engagement, qui dépend alors entièrement des choix et propositions des enseignants contraints par les éditeurs.
L’histoire bénéficie d’un prestige social fort et d’une visibilité médiatique alors que l’image de la géographie est ternie par des pratiques scolaires qui n’existent plus, mais qui persistent dans l’imaginaire collectif comme l’apprentissage de la carte des départements et des régions. La géographie est pourtant de plus en plus mobilisée dans les médias comme support de démonstration des grands enjeux géopolitiques et environnementaux, et il y a donc un enjeu démocratique à débattre sur la place publique des contenus qui y sont enseignés.![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.



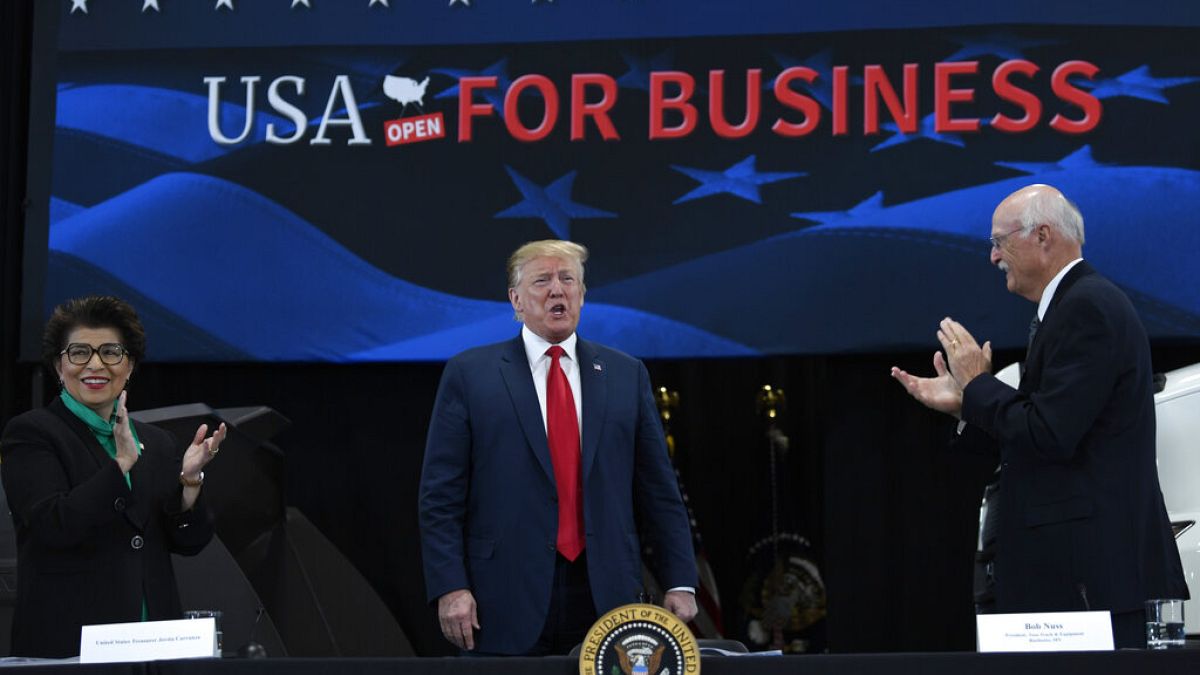




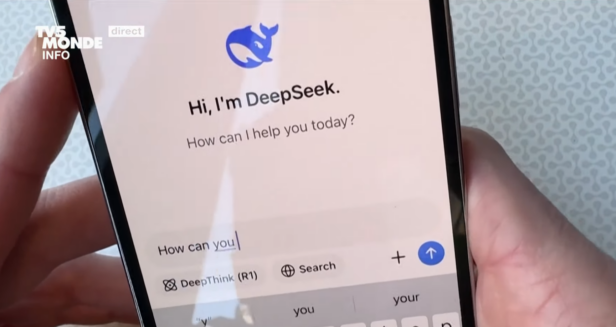


![[EXPO] Le musée Rodin tendance woke : sus à la grossophobie et au mâle blanc !](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/vignette-rodin-balzac-616x347.jpeg?#)