Renaissance du Louvre : entre gloire et fissures, quel avenir pour le plus grand musée de France ?
Emmanuel Macron annonce une « nouvelle renaissance » du musée du Louvre. Ce chantier colossal de 10 à 15 ans de travaux soulève de nombreuses interrogations.

À la suite d’une note alarmante de la présidente du Louvre évoquant de nombreuses « avaries » menaçant à la fois la sécurité des visiteurs et la préservation des œuvres, Emmanuel Macron annonce une « nouvelle renaissance » du musée. Ce chantier colossal de 10 à 15 ans soulève de nombreuses interrogations. Pour Marie-Alix Molinié-Andlauer, « le Louvre n’est pensé que comme un symbole, il est déterritorialisé ». Les réalités opérationnelles seraient-elles sacrifiées au profit de belles annonces devant la Joconde ? Décryptage.
Problèmes de sécurité, équipements techniques obsolètes, climatisation défaillante pour les œuvres, ascenseurs en panne pour les personnes à mobilité réduite… Le Louvre se délite à vue d’œil et pourtant ce musée continue à attirer toujours plus de monde (9 millions d’entrées en 2024).
Les chiffres de fréquentation témoignent d’une tension entre l’attractivité de ce musée et les contraintes structurelles liées au bâtiment – un ancien palais royal empêchant d’accueillir plus de visiteurs. La particularité de ce géosymbole est sa proximité avec le pouvoir, notamment le pouvoir présidentiel. Les grands travaux du Louvre sont impulsés en 1981 par le président Mitterrand ; en 2000, le président Chirac inaugure le pavillon des Sessions ; en 2012, c’est au tour du président Hollande d’inaugurer le nouveau département des arts de l’Islam. En 2017, Emmanuel Macron célèbre sa victoire devant la pyramide et, en 2025, il annonce la « nouvelle renaissance » du Louvre.
C’est toute la particularité du musée du Louvre qui, au-delà d’un patrimoine national, est un véritable symbole. Outre ces événements, le musée accueille régulièrement des visites d’État pour montrer une certaine image de la culture française. Pourtant, celle-ci n’est pas un bloc homogène. Elle se conjugue au pluriel et aujourd’hui elle se morcelle dans la société, mais également dans et au-delà des murs du plus grand musée de France.
Les ambitions contemporaines des président(e) s
Parmi les annonces d’Emmanuel Macron pour cette « nouvelle renaissance du Louvre », la première est le déplacement du tableau le plus emblématique du musée, la Joconde (symbole de la période Renaissance). Actuellement, elle est exposée dans la salle des États et est entourée d’une quarantaine d’œuvres, devenues invisibles tant cette voisine captive le public. L’idée serait de la déplacer sous la Cour carrée, pourtant située en zone inondable, à proximité de la nouvelle entrée du musée. Munis d’un billet spécial, les visiteurs pourraient alors la contempler dans un espace qui resituerait l’œuvre dans l’histoire de l’art. Une expérience 100 % Joconde serait donc proposée.
La deuxième annonce est celle d’une entrée au niveau de la colonnade, de Perrault, à l’est du musée. Cet espace, entouré par les « fossés Malraux » est peu accueillant et peu praticable en temps de pluie, accentuant la rupture avec la ville. Intégrer une nouvelle entrée à cet endroit permettrait de redéfinir et désengorger les circulations au sein du musée.
En revanche, le déplacement d’une telle entrée ne doit pas résulter d’un déplacement du problème d’un point A vers un point B. Il s’agit de réfléchir à comment mieux intégrer des entrées – ce qui en contexte Vigipirate relève de l’exploit – pour repenser la circulation dans sa globalité et une meilleure relation entre le Louvre et la ville. Car, outre les fossés qui sanctuarisent le musée au cœur de la ville, les différentes architectures urbaines – renaissance et néoclassique du musée et haussmanniennes pour les bâtiments voisins – accentuent cette rupture. Il y aurait une réflexion architecturale à mener pour redessiner cette partie du paysage urbain de Paris à l’aide d’un travail de « contraste retardé » qui favoriserait l’articulation entre les espaces.

Enfin vient l’idée d’un tarif plus élevé pour les visiteurs étrangers extra-européens. Cette augmentation comblerait en partie le manque à gagner pour enclencher toutes ces mesures. Emmanuel Macron a indiqué qu’elles ne coûteraient pas un centime aux contribuables. Pourtant, le coût des travaux serait estimé à plus de 700 millions d’euros, une somme vertigineuse quand on connaît le contexte économique actuel.
On peut notamment s’interroger sur la possibilité de mettre en place cette tarification spéciale sans porter atteinte à la protection des données personnelles. Y aura-t-il une obligation d’acheter son billet en ligne et d’y présenter son passeport ? Des files seront-elles créées, comme à l’aéroport, avec une ligne pour « Européens » et une autre pour le public « extra-européens » ? En ces temps troublés, l’idée d’une mesure stigmatisante des étrangers extra-européens ne devrait pas trouver écho au sein d’un lieu de culture et, qui plus est, au sein d’un lieu aussi emblématique que le musée du Louvre.
Emmanuel Macron parle de pouvoir accueillir 12 millions de visiteurs d’ici 10 à 15 ans. Avec ses couloirs étriqués et son architecture patrimoniale contrainte par le respect des normes des architectes des bâtiments de France, l’ancien palais royal ne peut absorber tant de visiteurs et, pourtant, le financement des travaux reposerait principalement sur la billetterie. En effet, si on reprend les quatre principales ressources du musée en 2023, en dehors des subventions de l’État qui sont autour de 100 millions d’euros, la première ressource est la billetterie (95,9 millions d’euros).
Viennent ensuite d’autres pôles qui seraient également mis à contribution : la licence de la marque Louvre Abu Dhabi (83,1 millions d’euros qui émanent de l’accord intergouvernemental signé en 2007 entre la France et les Émirats arabes unis et prolongé de 10 ans,jusqu’en 2047), la valorisation du domaine (25,2 millions d’euros) et le partenariat médias et mécénat (20,6 millions d’euros). Pour le mécénat, on suppose l’implication du groupe LVMH, ainsi que d’autres événements régulièrement accueillis par le musée. S’il est considéré comme fonds propre, il ne faut pas oublier que le mécénat est défiscalisé de 40 à 60 %, donc en partie payé par les contribuables.
Le symbolisme du Louvre confronté aux réalités du terrain
La question du financement de ces travaux laisse les syndicats du musée du Louvre circonspects. Plus largement, les annonces suscitent un accueil très mitigé. Aussi séduisantes soient-elles, elles paraissent déconnectées de la réalité du terrain, bien moins glamour, que vivent les salariés, contractuels et prestataires du fait des conditions de travail et d’accueil.
Ces grandes annonces traduisent un arbitrage difficile : opter pour un fonctionnement normal avec une jauge gérable au sein d’un musée hors norme, ou choisir un fonctionnement à flux tendu pour répondre à la demande d’un public toujours plus grand et désireux de visiter un symbole culturel.
Au-delà de l’expérience muséale, il y a une dimension pratique et matérielle. En 2016, le « projet Pyramide » à 53,5 millions d’euros était censé améliorer l’accueil des visiteurs face à la structure vieillissante de l’entrée principale, souvent assimilée à un hall de gare. Il n’a pas permis de réel changement, si ce n’est que les sorties se font par le Carrousel. Or, les individus de passage suffoquent aux premières chaleurs sous cette structure de verre. Dans le département des arts de l’Islam, la proximité avec la Seine provoque des odeurs parfois désagréables et, en temps de crue, les réserves sont en alerte. Le déménagement de certaines de ces réserves vers le Centre de conservation et de ressources à Liévin (Pas-de-Calais), non loin du Louvre-Lens, répond en partie à ce besoin de préservation et conservation des œuvres. Le musée est inadapté aux changements climatiques et aux pratiques muséales.
[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]
Penser le Louvre dans un maillage culturel et sociétal
Dans ce projet, il y a une ambiguïté entre une volonté de mieux intégrer le musée à son territoire et l’accueil de ces 12 millions de visiteurs. Car, que ce soit le Louvre ou son territoire alentour, aucun des deux ne peut absorber 12 millions de visiteurs par an, en termes de gestion des flux. Ce musée n’est pas un vaisseau déterritorialisé et sanctuarisé, il s’inscrit dans un territoire avec toute sa complexité.
Peut-être devrait-il plutôt être question de repositionner le musée dans la société, de favoriser une meilleure expérience qualitative du musée et de son territoire alentour ? Le Louvre est au cœur de Paris, dans un maillage culturel dense. Ces lieux de la culture doivent pouvoir se répondre pour permettre de changer de perspectives sur le Louvre et pour mieux le comprendre dans son ensemble urbain. Cette dimension territoriale ne peut se lire sans la dimension sociale attachée au musée : les discours proposés et les œuvres montrées sont autant de portes vers la confrontation à l’altérité.
La dimension symbolique et la notoriété du Louvre sont fortes. Ce musée en arrive à la fois à être désincarné de toute forme de spatialité et à incarner à lui seul la France. En 2017, le candidat Macron avait indiqué son intention de mettre en chantier le pays à coup de réformes successives. Après Notre-Dame de Paris, le Louvre deviendra un chantier de plus, mais à destination de quelle France ?
Le Louvre a également une dimension politique dans le sens noble du terme. Lieu de pouvoir, lieu de rencontre, lieu de revendication contre des mécènes aux pratiques environnementales douteuses ou pour justifier les restitutions des œuvres d’art. Le Louvre montre aux yeux du monde des géographies et des positionnements pluriels au service de l’histoire de l’art et de l’histoire contemporaine. Il est infiniment politique, il s’y reflète toute la complexité et toutes les contradictions de notre monde, tel un miroir de notre société, où les barrières symboliques et physiques s’érigent, au lieu d’œuvrer pour tous les ponts qui mériteraient d’être créés.![]()
Marie-Alix Molinié-Andlauer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.








![[SATIRE À VUE] Emmanuel Macron poursuit sa tournée des bar-tabac](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/macron-cafe-grok-616x347.jpg?#)

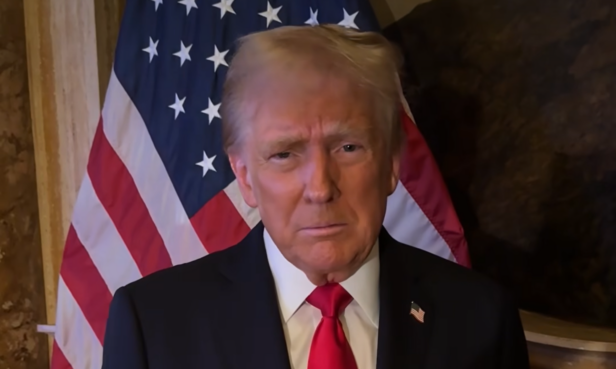





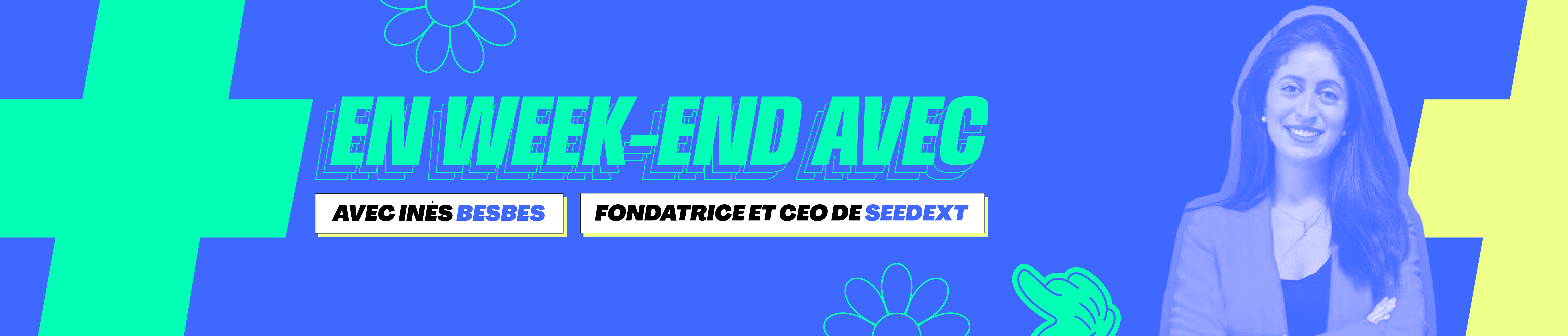
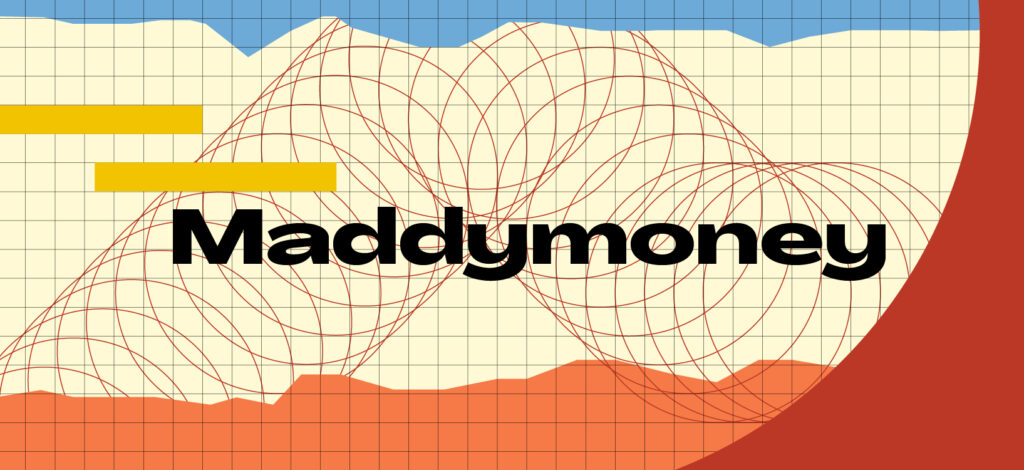



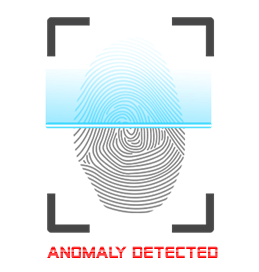








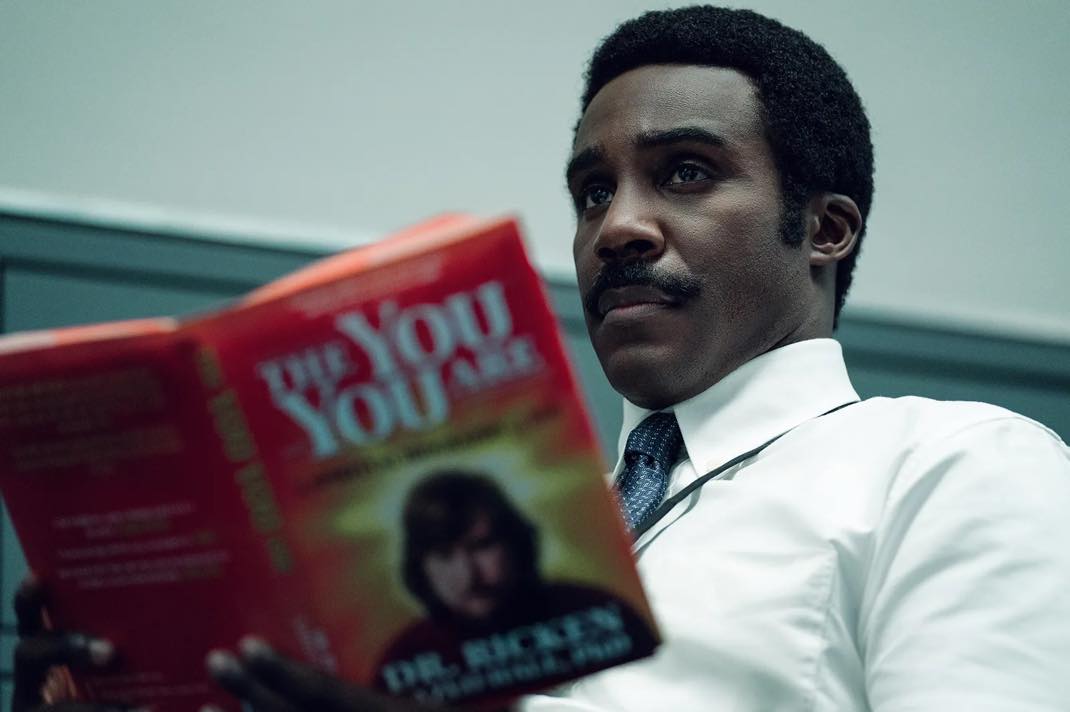
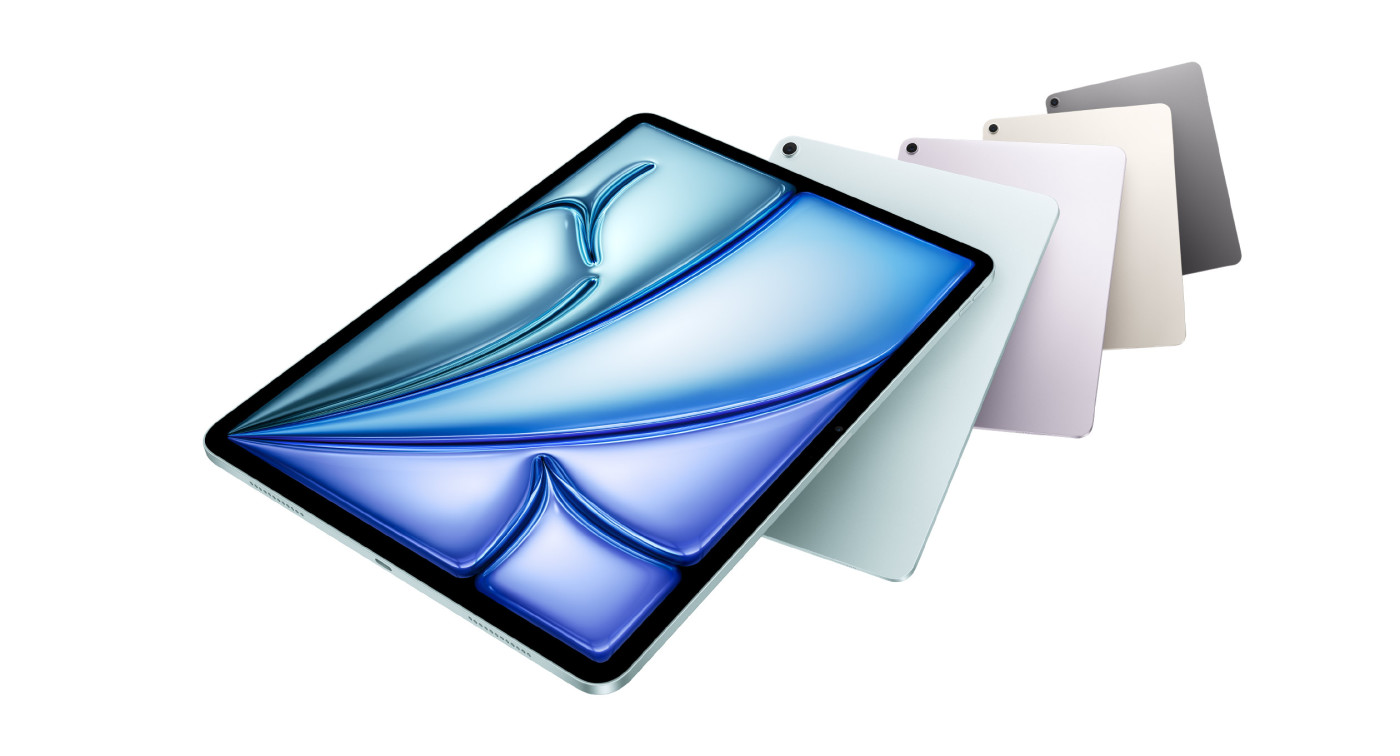




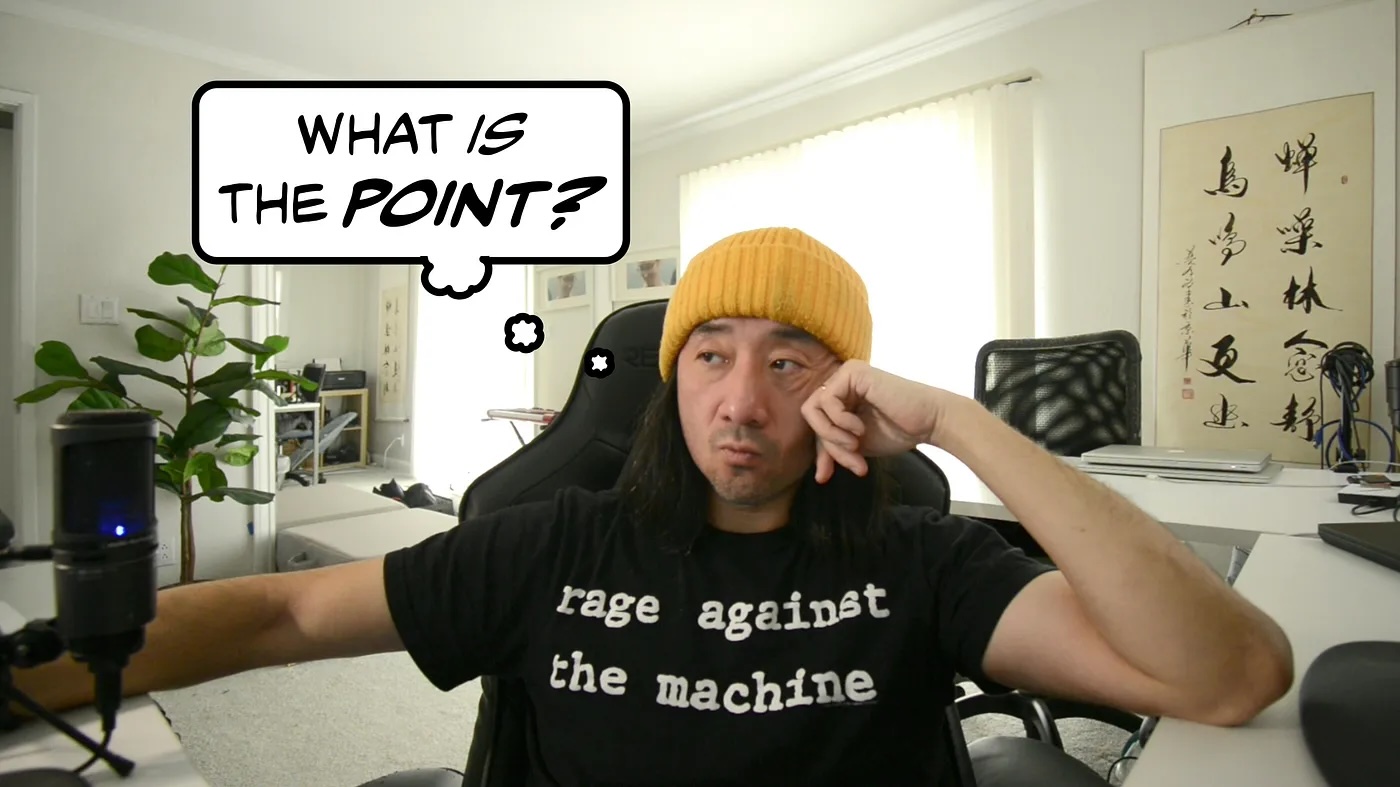
















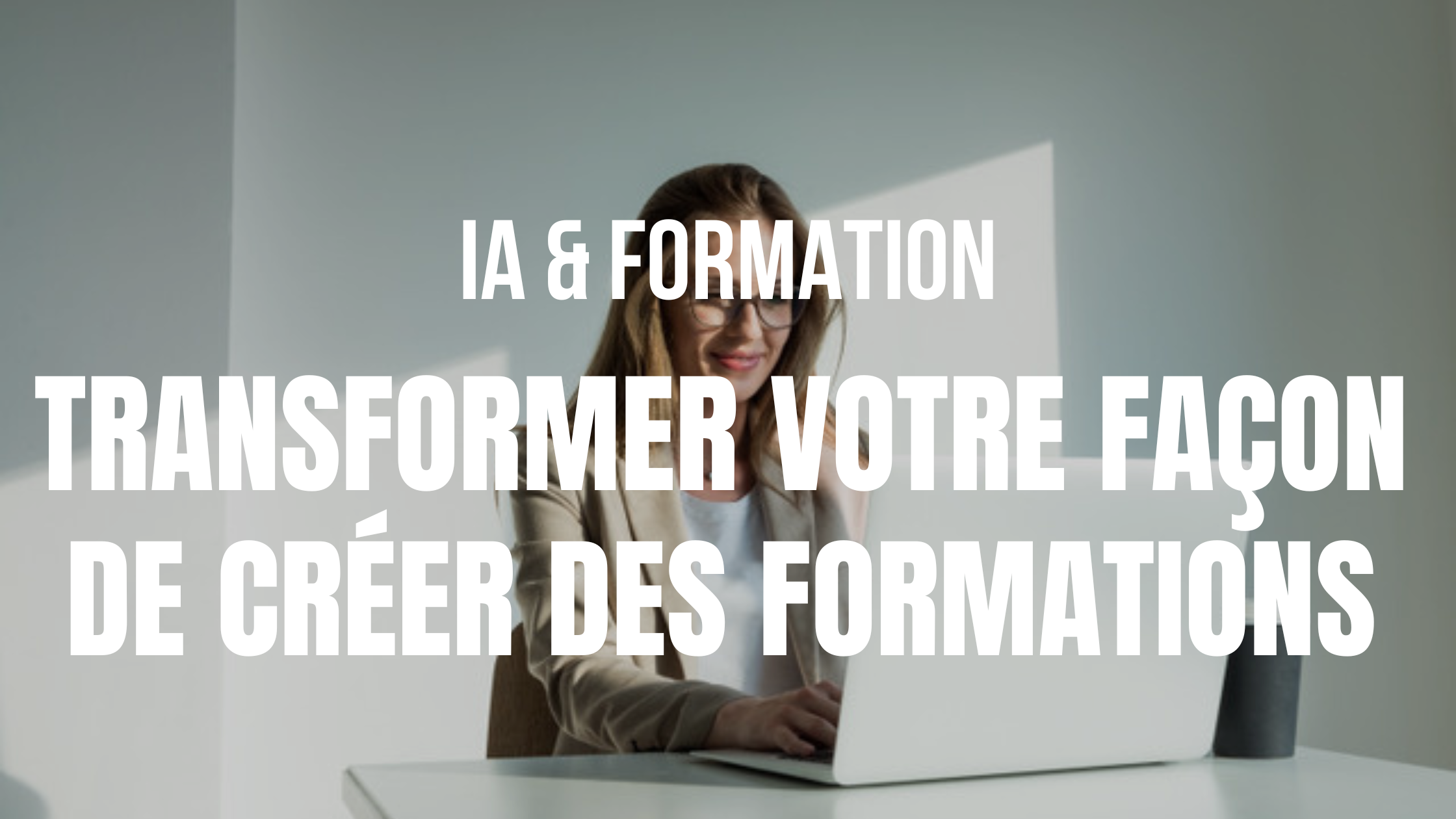

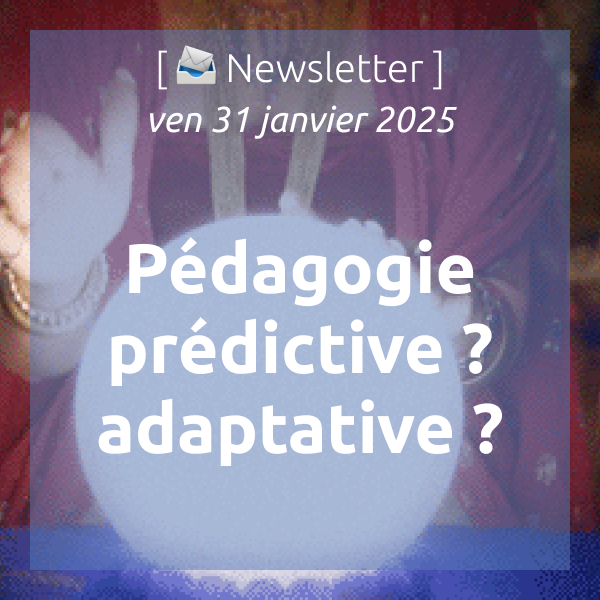



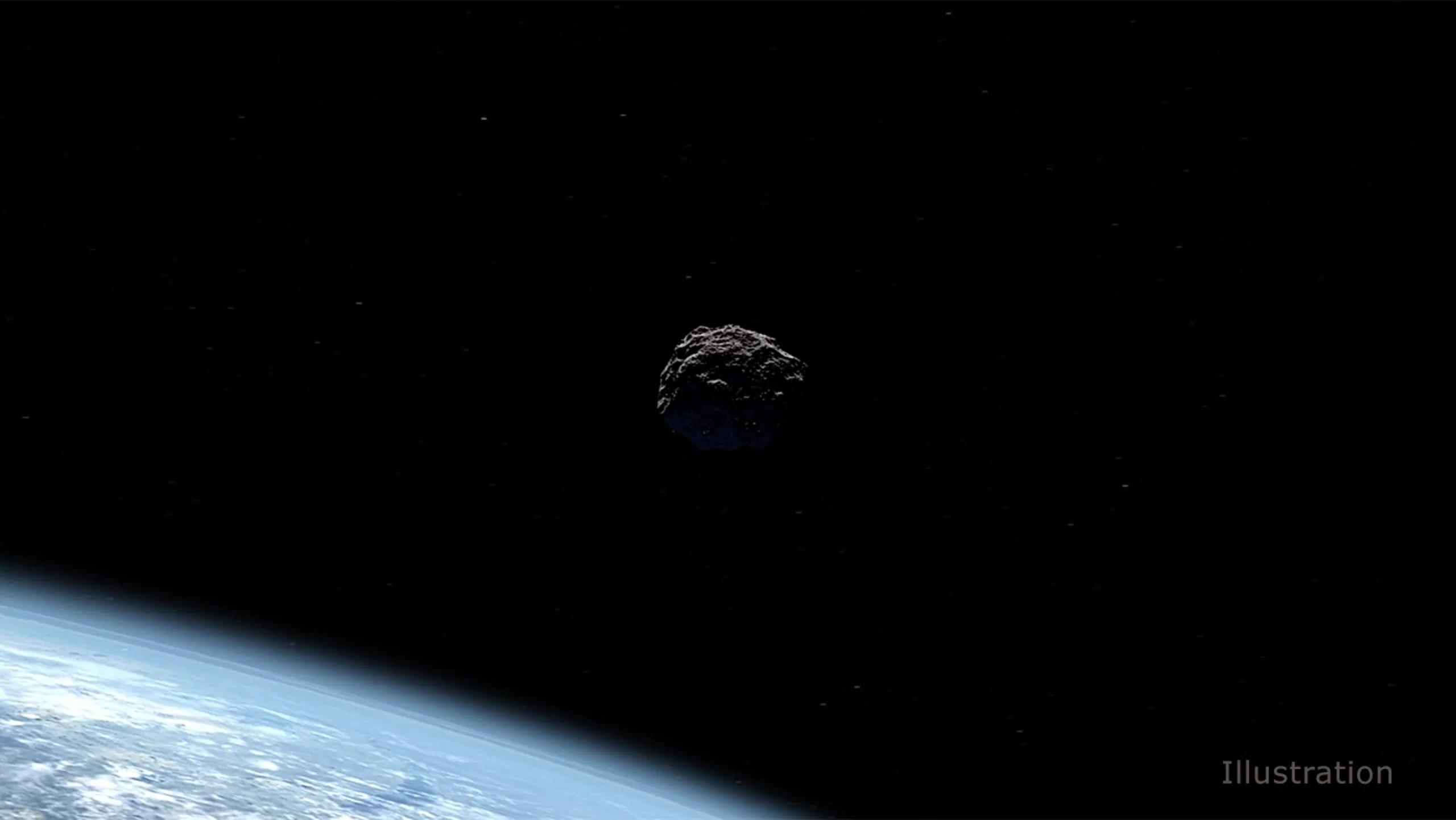


![« Ce n’est pas parce qu’on reçoit qu’on adhère » : Raphaël Schellenberger, député [3/3]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_3080.jpg)


















