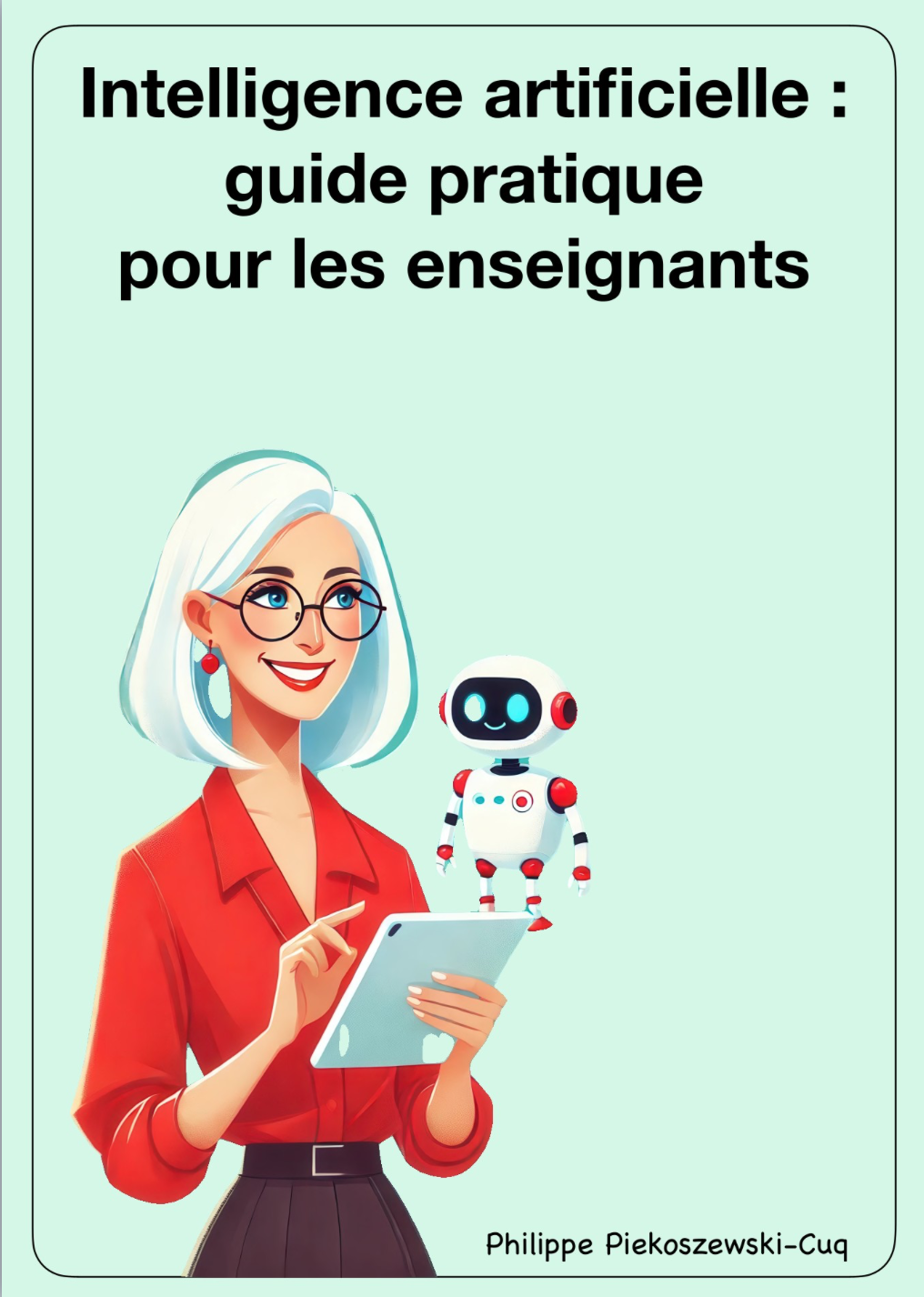Une loi pour contrer la désinformation environnementale ?
Entre juin et décembre 2024, seuls 3,4 % des contenus télévisuels étaient consacrés à l’environnement. Une loi pourrait-elle y changer quelque chose et empêcher aussi la désinformation climatique ?

Entre juin et décembre 2024, seuls 3,4 % des contenus télévisuels étaient consacrés à l’environnement. Une loi pourrait-elle y changer quelque chose et empêcher aussi la désinformation climatique ?
À l’heure où les réseaux sociaux se désengagent du « fact-cheking », on assiste en France à un mouvement à rebours, avec des tentatives de régulation de l’absence d’information, voire de désinformation, médiatique en matière d’environnement.
En partant de l’idée que les médias constituent un levier incontournable à la transition écologique, plusieurs députés ont constitué un groupe transpartisan de réflexion à l’été 2023 sur la qualité, la quantité et l’accessibilité des informations médiatiques relatives à l’environnement.
Une proposition de loi a été présentée le 13 novembre 2024 à l’Assemblée nationale et doit désormais être examinée. Il s’agit d’un texte « visant à garantir le droit d’accès du public aux informations relatives aux enjeux environnementaux et de durabilité ».
Mais qu’est-ce qui motive cette proposition de loi et que contient-elle ?
La production de l’information environnementale et ses risques
L’information est ici considérée comme le socle de l’action. Sans connaissance, sans prise de conscience, de nouveaux horizons ne peuvent s’ouvrir et l’on ne peut entrevoir et s’approprier de nouvelles manières d’agir.
Les médias sont soumis actuellement à de fortes attentes sociales concernant le traitement médiatique de questions prégnantes, parmi lesquelles l’écologie et les différentes crises environnementales qui s’entrecroisent : réchauffement climatique, érosion de la biodiversité, généralisation des pollutions, raréfaction des ressources, etc.
Selon le rapport de l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) de mars 2024 intitulé « Les Français et l’information », il apparaît que les Français se sentent peu et mal informés sur la thématique « environnement, climat, écologie », bien qu’elle soit identifiée comme leur deuxième centre d’intérêt.
À lire aussi : Audiovisuel : sanctionner sans censurer, la difficile mission de l'Arcom
Or le traitement des questions environnementales demande aux journalistes des connaissances variées, en plus d’une actualisation constante. De surcroît, la démultiplication d’acteurs et de formats informationnels peut soumettre les questions environnementales à un double mouvement de mésinformation et de désinformation : alors que la première concerne la réception par les publics d’informations qu’il croit véridiques et crédibles, la deuxième, incarnée par les fake news, est un acte intentionnel qu’un acteur réalise pour sauvegarder ses intérêts.
Actuellement, si des contenus médiatiques comportaient une part de désinformation, le seul moyen permettant de demander un droit de réponse consiste en une saisine du Conseil de déontologie journalistique et de médiation, instance de médiation et d’autorégulation composée de journalistes bénévoles. S’agissant d’une association avec des moyens limités, le CDJM fait face à un grand flux de requêtes concernant des fake news relatives à l’environnement sur lequel il ne peut statuer rapidement. En outre, il se fonde sur la bonne volonté des parties prenantes et n’a pas un pouvoir de sanction.
Le texte proposé envisage une réorganisation du traitement médiatique des enjeux écologiques, d’autant plus importante que la crise que nous traversons n’en est pas vraiment une en réalité. Une crise par définition est temporaire, elle connaît un début et une fin. Or les problématiques environnementales commandent de transformer durablement notre manière d’être au monde. Certains défis contemporains, tels que la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique, sont colossaux. Ils redessinent le monde et suggèrent une véritable réorientation de notre rapport à la production et à la consommation des biens et des services.

Pour suivre au plus près les questions environnementales, retrouvez chaque jeudi notre newsletter thématique « Ici la Terre ».
Élargir le rôle de l’Arcom
Comment chaque citoyen peut-il imaginer une société prenant en compte ces nouveaux impératifs, tel que le commande l’objectif de développement durable (inscrit dans le premier article, L. 110-1, du Code de l’environnement), sans être dûment informé ?
C’est à cette question que tâche de répondre le premier article de la proposition de loi, qui souligne le rôle de l’Arcom en matière d’information environnementale et de protection de l’environnement, et propose l’élargissement de ses prérogatives. Cet article propose par exemple d’ajouter aux missions de l’Arcom, la garantie d’un « traitement adapté des [enjeux environnementaux] en qualité et quantité lors des campagnes électorales » ou encore l’inclusion « dans les conventions que les chaînes de télévision et les radios concluent avec l’Arcom des volumes horaires dédiés aux enjeux environnementaux. »
Pour rappel, lors de la dernière campagne présidentielle, le temps consacré au climat dans les médias avait stagné entre 1 % et 5 %, selon le baromètre de l’Affaire du Siècle, et sur le dernier semestre 2024, l’environnement n’a été abordé que dans 3,4 % des contenus d’information télévisuels.
Ce premier article se fait de surcroît l’écho aux articles 2 et 7 de la Charte de l’environnement, consacrant respectivement le devoir constitutionnel de protéger l’environnement et le droit à l’information.
Institutionnaliser l’Observatoire de la couverture médiatique de la crise écologique
L’article 2 porte, quant à lui, sur la pérennisation et l’institutionnalisation d’un observatoire de la couverture médiatique de la crise écologique, qui existe déjà grâce à l’initiative des associations et d’institutions publiques. À partir d’une analyse des flux audiovisuels, l’Observatoire a procédé à la quantification du temps d’antenne dédié à l’écologie dans les émissions d’information générale. Le constat n’est guère optimiste : l’année 2024 comptabilise 30 % de sujets environnementaux en moins par rapport à l’année précédente à la télévision. Une deuxième étape prévoit d’analyser les contenus de la presse écrite.
Au-delà de la gestion du temps consacré à ces questions, cette loi a vocation à guider une transformation en profondeur des médias. De manière plus ambitieuse, l’article 4 définit la mission du service public de l’audiovisuel concernant l’information sur la crise écologique. La mission actuelle de France Télévisions et Arte est précisée pour intégrer les enjeux environnementaux, et une mission identique est explicitement dévolue à Radio France.
Des contrats et des chartes
Pour ce faire, différents outils juridiques sont mobilisés. Le contrat, tout d’abord, puissant instrument qui présente la particularité d’engager fortement les parties. L’article 5 rend obligatoires les « contrats climat », dispositif ayant pour vocation d’inciter les entreprises à souscrire des engagements volontaires, publics et soumis à des reporting pour démontrer leur effectivité.
La soft law (ou, « droit mou ») est aussi utilisée au sein de cette proposition, car ce sont les chartes qui sont visées à l’article 6. À la différence du contrat, les chartes ont pour fonction de donner une conduite à tenir, libre au destinataire de la charte d’appliquer ou non ces conseils. Cet article ajoute ou complète un volet au sein des chartes déontologiques des sociétés médiatiques afin d’assurer une couverture équilibrée et homogène des enjeux écologiques.
Évoquer à la fois des contrats et des chartes peut sembler redondant, mais ces deux types de dispositifs ne le sont aucunement. À visée persuasive, la modalité de la charte se fonde sur un principe d’adhésion volontaire des médias, alors que celle du contrat fonctionne sur la dissuasion, obligeant dès lors les médias à bannir les fake news environnementales.
Remarquons que l’adhésion des entreprises médiatiques au projet d’une information équilibrée et sourcée en matière d’environnement n’est pas présentée comme allant de soi. En effet, l’article 6 cherche à l’encourager ou à la renforcer en faisant des propositions concrètes : traiter l’actualité à la lumière de la justice sociale et des enjeux environnementaux, privilégier des cadrages axés sur les causes, les conséquences et les solutions aux problèmes d’écologie, former de manière continue les personnes productrices de cette information.
Enfin, l’article 7 renforce les moyens d’investigation de l’Arcom pour le suivi des dispositions applicables spécifiquement aux plates-formes en ligne, dans le cadre du devoir de coopération en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations, en s’appuyant sur les récentes évolutions du droit européen (Digital Services Act, DSA) et en y intégrant les enjeux écologiques.Si l’article n’explicite pas les sanctions prévues pour les plates-formes numériques, il indique que « les autorités judiciaires et administratives » sont en mesure d’agir pour endiguer la diffusion de contenus désinformationnels.
Activer les leviers du droit, entre craintes et espoirs
L’urgence écologique est un thème qui, selon cette proposition, doit investir une place plus importante dans les médias sans que cela constitue une menace pour la liberté de la presse. En droit, l’exercice des droits et libertés est savamment organisé de manière à parvenir à un juste équilibre entre le droit à l’information de chacun et la liberté de la presse, cette dernière étant une branche puissante de la liberté d’expression. Cette conciliation est doublement nécessaire au regard des enjeux en question, mais également en considération de la nature de ce droit à l’information du public, qui est érigé au rang de droit constitutionnel depuis 2004 (art. 7 de la Charte de l’environnement).
Cette tension entre liberté de la presse et lutte contre la désinformation environnementale se cristallise dans la réception du projet par les médias et les journalistes. Elle est présentée par certains comme une proposition permettant de « mieux parler » ou de « mieux traiter la crise environnementale » quand d’autres y voient un outil « contre le climatoscepticisme ». À l’opposé, elle suscite la crainte d’une imposition des lignes éditoriales voire une censure des contenus. Toutefois, comparer fiabilité et équilibre informationnel avec contrainte de l’exercice journalistique semble disproportionné à l’égard des urgences mettant en péril la vie sur terre, tel que nous la connaissons. Nul doute que cette conciliation se fera aisément : d’ores et déjà, la liberté de la presse a su prendre en compte d’autres droits fondamentaux à l’instar du droit à la vie privée.![]()
Nataly Botero est membre du comité d'experts de l'Observatoire des Médias sur l’Écologie.
Sabrina Dupouy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
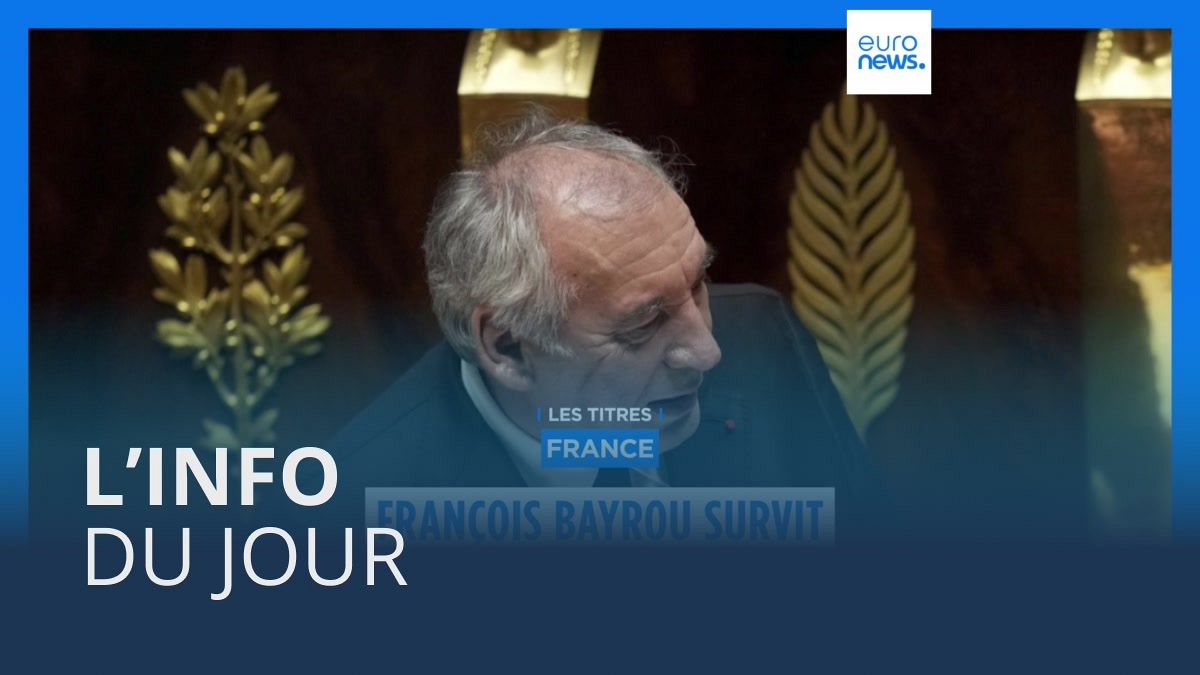
















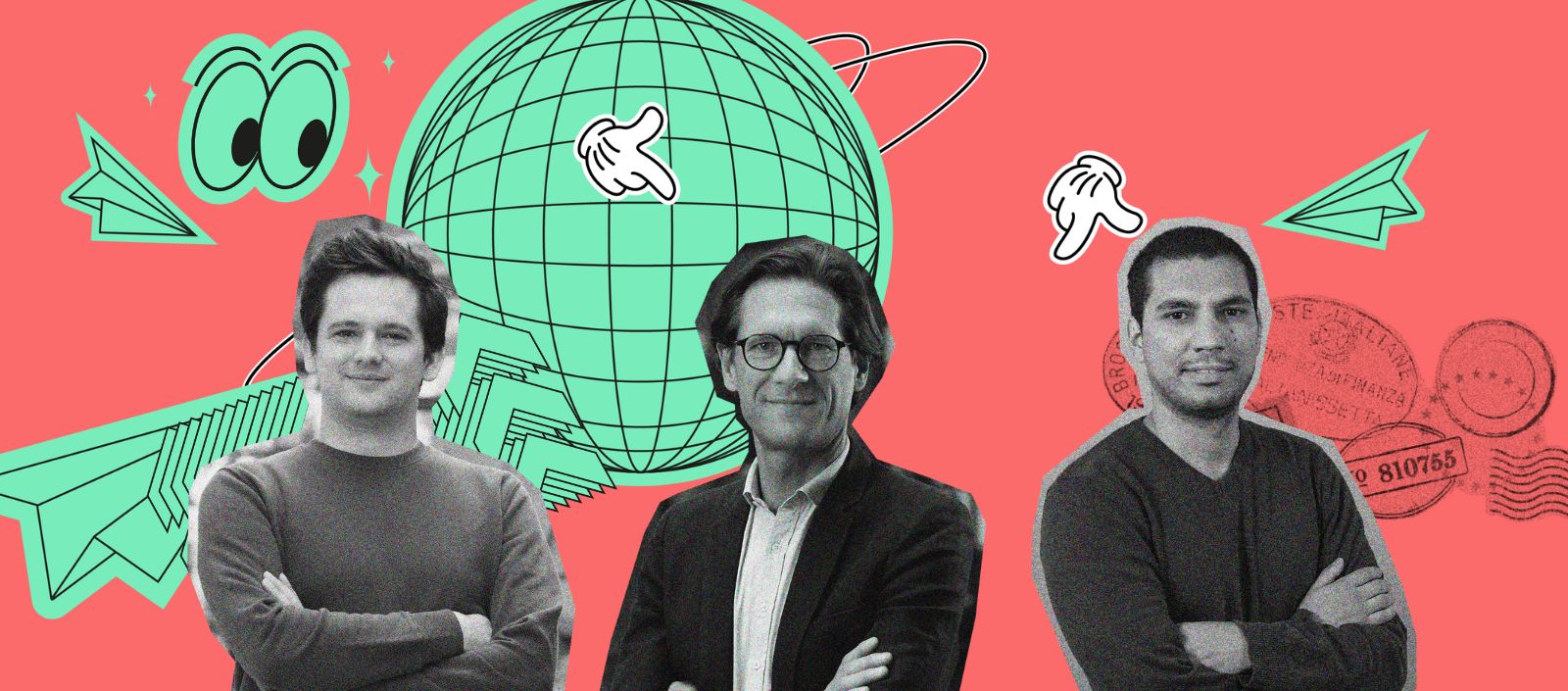




















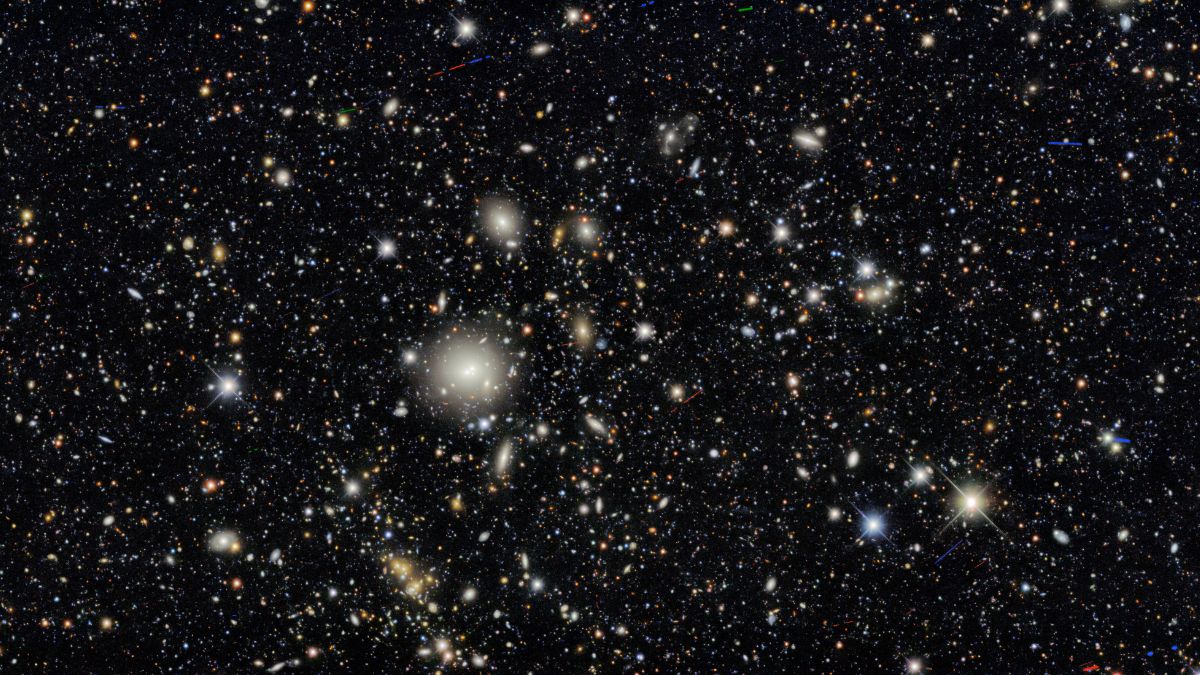






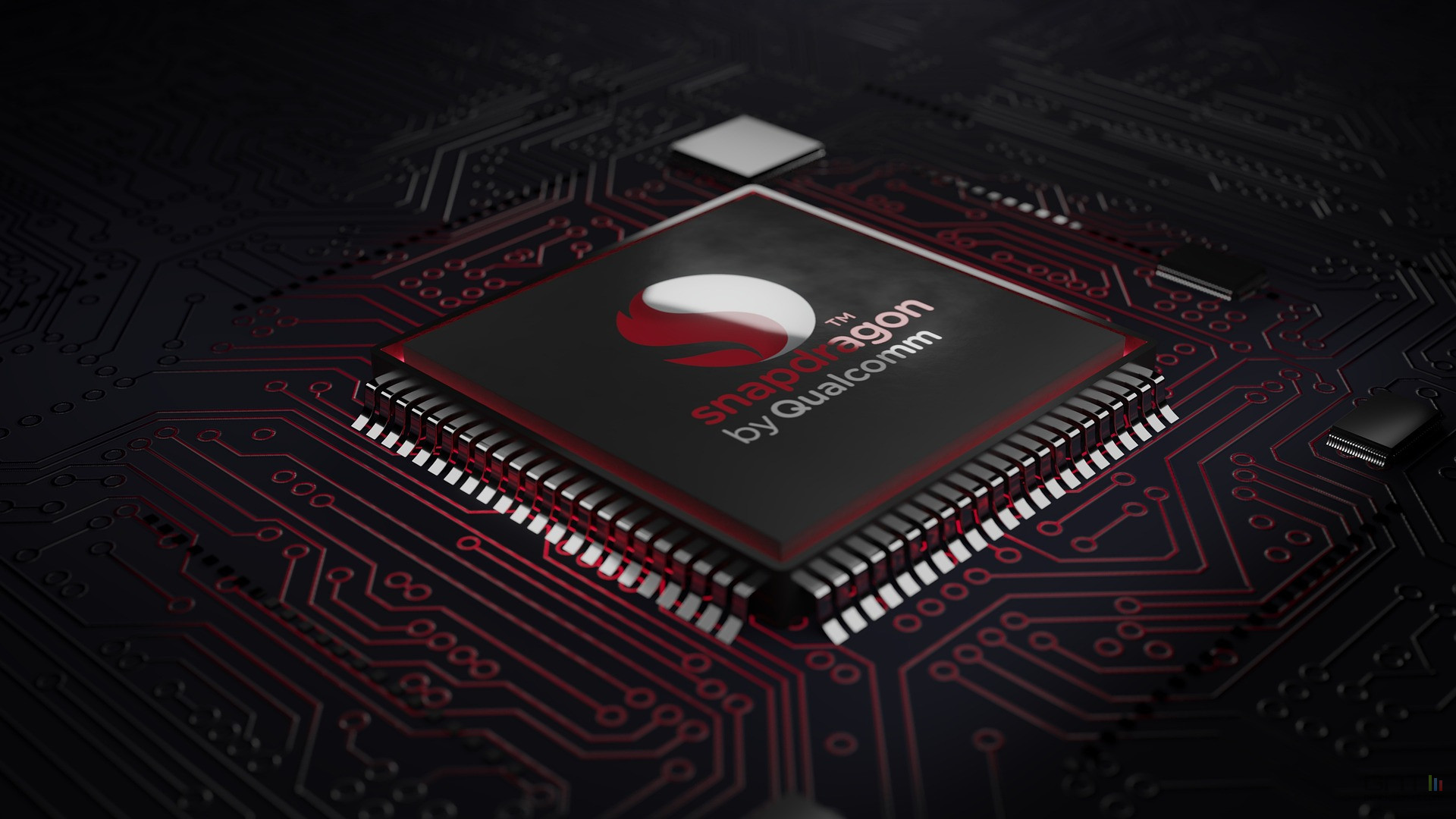



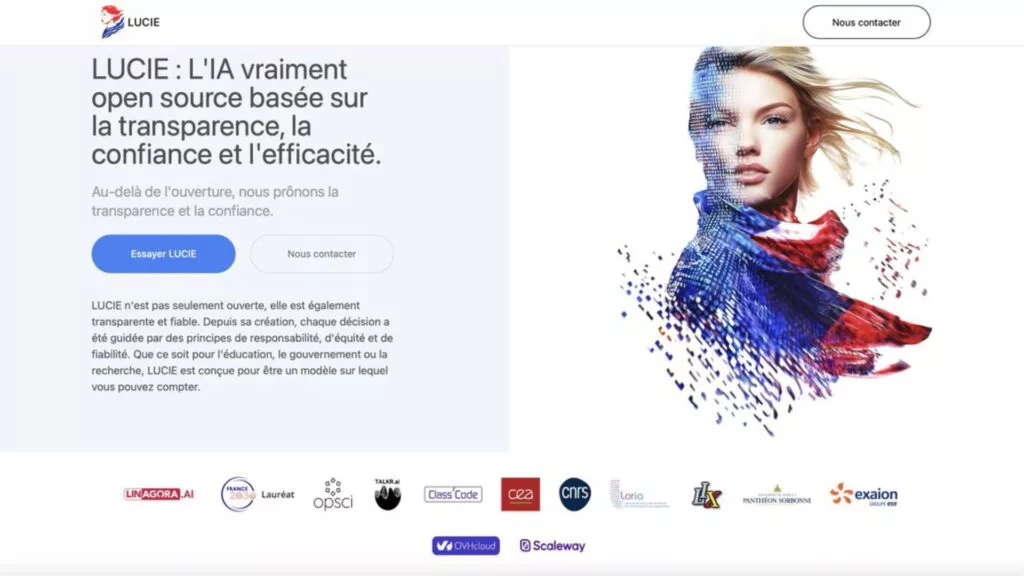


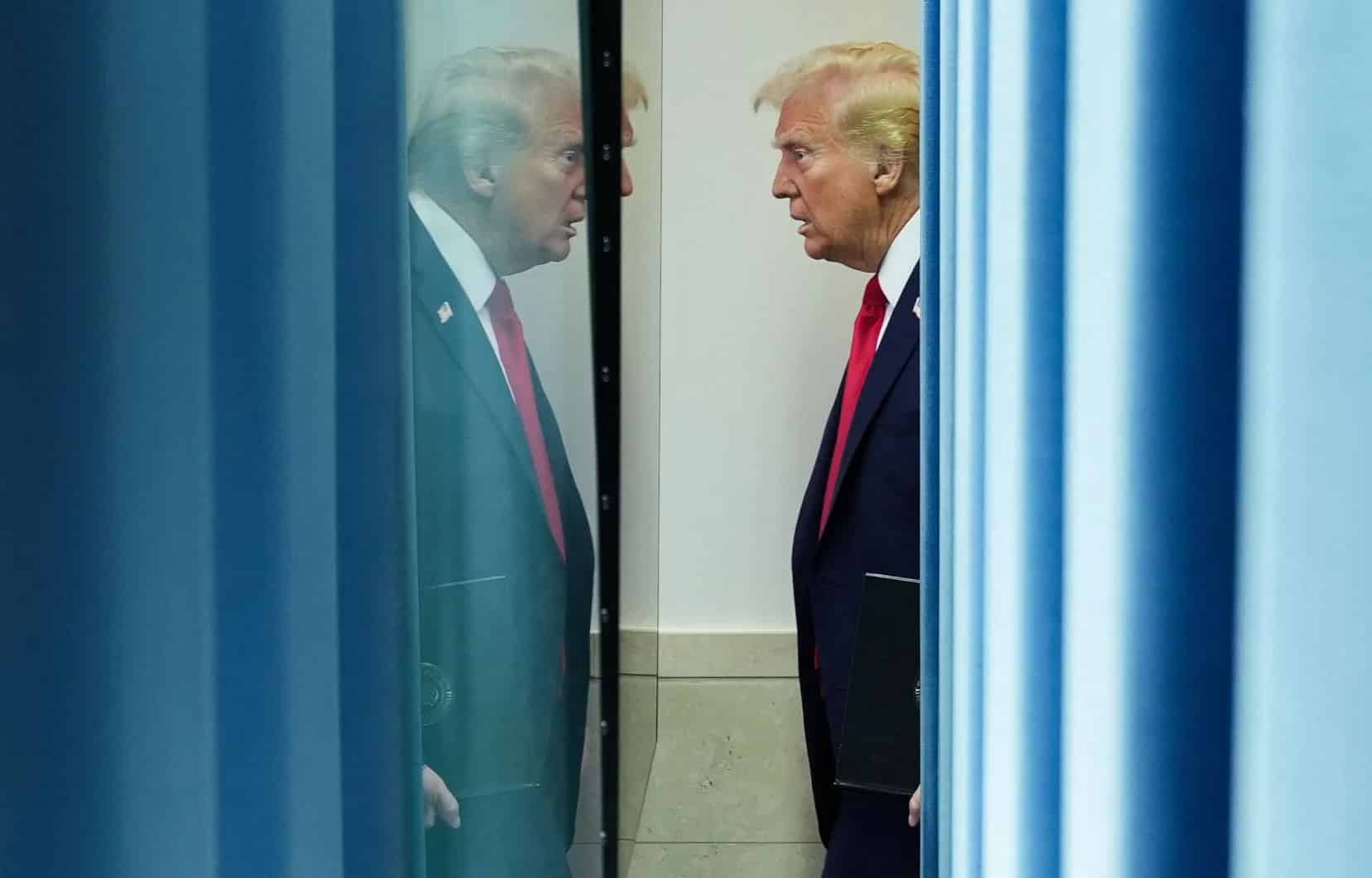



.png?#)