Protectionnisme et géopolitique : le retour de l’Histoire
L’élection de Donald Trump et son programme agressif en matière de relations économiques signe-t-elle la fin du libre-échange ? La réalité est beaucoup plus complexe.

Avec le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, de nombreux experts s’inquiètent d’un retour du protectionnisme, après des années de libre-échange. Pourtant, l’opposition entre les deux termes ne doit pas occulter que la réalité est plus complexe. Le libre-échange intégral n’existe pas. Retour sur l’histoire d’un concept et des pratiques observées.
Le retour du protectionnisme dans le monde doit s’apprécier sur le temps long de l’Histoire et par rapport à ce que celle-ci nous a enseigné sur le lien du protectionnisme avec le nationalisme, le repli et les conflits internationaux. L’analyse doit être menée au niveau des principes, de la pratique et du droit, en remettant en perspective les évolutions récentes par rapport aux deux étapes fondamentales qu’ont été la signature du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) en 1947 et la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995.
Les bénéfices du libre-échange ont été mis en valeur par la théorie des avantages absolus d’Adam Smith et celle des avantages comparatifs de David Ricardo. Suivant ces théories, le libre-échange apporte un gain collectif pour les parties qui s’y prêtent parce qu’il accroît la spécialisation, la division du travail et la connexion des économies nationales. Ce gain augmente la prospérité collective en même temps qu’il accroît les échanges entre les peuples et favorise l’adoucissement des mœurs (selon la théorie du « doux commerce » de Montesquieu).
Mondialisateurs et mondialisés
Face à cette vision positive, le protectionnisme a aussi eu ses défenseurs, notamment pour corriger les effets d’un échange inégal entre les nations, qui profite surtout à celles qui sont développées. Peu après la création du Zollverein en 1834 (une union douanière autour de la Prusse), l’Allemand Friedrich List a défendu un protectionnisme « éducateur » pour permettre à l’Allemagne de monter en gamme avant de libérer ses échanges. Plus près de nous, des économistes comme Raul Prebisch ont demandé un traitement favorable des pays en voie de développement dans le commerce mondial, qui s’applique aujourd’hui sous la forme de plusieurs dispositifs : le « système des préférences généralisées » (1971), l’importation par l’UE des produits des pays les moins avancés sans droits de douane (« Tout sauf les armes », 2001), et l’aide publique au développement apportée par les pays riches.
Dans la mondialisation, il y a les mondialisateurs et les mondialisés, comme l’a souligné Hubert Védrine. Le libre-échange a été porté par l’Empire britannique au temps où il dominait la mer, le commerce, le capitalisme industriel et financier et les terres colonisées en Afrique et en Asie. Jean Monnet raconte dans ses Mémoires combien il a été difficile de convaincre cette grande puissance libérale de créer un pool du ravitaillement et du transport pour soutenir l’effort de guerre allié pendant la Première Guerre mondiale.
Préférence impériale après 1929
Mais le libre-échange n’a jamais été institué à l’échelle internationale jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Les tendances protectionnistes étaient fortes avant 1914 (par exemple la loi Méline en France, 1892, ou les tarifs Mc Kinley et Dingley aux États-Unis), elles ont coexisté avec une montée des nationalismes et des tensions internationales, mais aussi avec une forte croissance économique. Après la Première Guerre mondiale, la Société des nations visait à reconstruire la paix sur les principes de la sécurité collective, sans faire du libre-échange un pilier essentiel, malgré la conférence économique tenue à Genève en 1927.
La crise de 1929 a sanctionné le manque d’organisation économique internationale, et a été suivie d’un repli général des nations derrière les tarifs douaniers (le tarif Hawley Smoot aux États-Unis en 1930) et les empires coloniaux pour les puissances qui en avaient un. Le Royaume-Uni a ainsi tourné le dos à ses principes libre-échangistes en établissant la « préférence impériale » (Conférence d’Ottawa, 1932). Le reflux du commerce international, concomitant de la montée du fascisme (et du communisme), s’est terminé par la Seconde Guerre mondiale.
Conjuguer la paix et les échanges économiques
C’est pour surmonter ces échecs à conjuguer la paix et les échanges économiques qu’un nouveau système, promu par les États-Unis, a vu le jour autour de l’ONU, du Fonds monétaire international et du GATT. Mais si l’ONU se voulait un système de paix universel (rapidement paralysé par la guerre froide), la coopération économique internationale s’est développée entre pays occidentaux, qui ont de plus en plus libéralisé les échanges entre eux. L’Union européenne a fait du libre-échange son principe fondateur, par le marché commun (1957) puis unique (1993), ce qui a été poussé par les États-Unis (dès le plan Marshall en 1947) puis par l’Allemagne, devenue à la fin du XIXe siècle une grande puissance industrielle et commerciale. Et l’UE est devenue elle-même une machine à libéraliser les autres (une quarantaine d’accords de libre-échange).
C’est seulement à la fin de la guerre froide, à une époque de domination sans partage des États-Unis, que le GATT (sous sa nouvelle forme de l’OMC) et le FMI ont pu devenir quasi universels. L’entrée de Pékin dans l’OMC en 2001 a prodigieusement accéléré le rattrapage économique chinois, au point que la Chine est devenue la première puissance commerciale mondiale en espérant devenir aussi la première puissance économique et politique tout court.
À lire aussi : Avec le retour de Donald Trump, l’OMC plus que jamais en état de mort cérébrale trente ans après sa création
Une pratique pour les pays vertueux ?
Les États-Unis, et plus généralement les pays occidentaux, ont aujourd’hui cessé de croire aveuglément au principe du libre-échange porteur de paix et de démocratie. Comme l’a expliqué Maxence Brischoux, le commerce libre n’a de sens qu’entre pays vertueux, ce qui peut être contesté dans le cas de la Chine. Par ailleurs, la mondialisation s’est traduite par des délocalisations qui ont nourri la frustration des classes moyennes et populaires, ce qui n’est pas pour rien dans la montée des partis populistes. Cette problématique est devenue de plus en plus importante aux États-Unis depuis l’apparition en 1971 d’un déficit commercial structurel.
La géopolitique a désormais repris ses droits face au principe du libre commerce, comme l’a montré le concept de « friendshoring » popularisé par la secrétaire au Trésor américain Jannet Yellen. Et le second mandat de Donald Trump nous plonge dans deux dilemmes essentiels qui se posent maintenant aux Occidentaux : cesser de promouvoir le libre-échange au risque d’accélérer les tendances au repli nationaliste et aux conflits, comme ce fut le cas avant la Seconde Guerre mondiale ; recréer des barrières aux échanges au risque de perdre les gains tirés du commerce, notamment à travers l’inflation qui frappe les plus pauvres.
La pratique du libre-échange et ses limites
Or, tout n’est pas blanc ou noir quand on parle de la liberté des échanges. À travers les « cycles » (rounds) successifs de libéralisation du GATT, les tarifs moyens sur les produits industriels sont passés de 40 à 3 %. Les échanges sont donc très largement libéralisés au niveau mondial, ce qui a favorisé ce qu’on appelle la « mondialisation » : le commerce international représente 30 % du PIB (cela n’a jamais été plus de 15 % avant 1945). Mais tout n’est pas libéralisé, tant s’en faut.
La sécurité est la première ligne rouge que les États entendent préserver. Adam Smith lui-même justifiait que le Royaume-Uni interdise l’accès de ses ports aux navires étrangers (notamment hollandais) pour développer la marine marchande britannique, au motif que « la sûreté de l’État est d’une plus grande importance que sa richesse ». C’est aussi sur ce fondement que les pays occidentaux ont restreint les échanges technologiques avec les pays communistes pendant la guerre froide, et ont multiplié ensuite les régimes de sanctions (dernièrement contre la Russie, de façon massive). Face à la Chine, l’objectif proclamé par Ursula von der Leyen mais aussi par les États-Unis est celui du « desrisking without decoupling », c’est-à-dire la réduction des risques plutôt que le découplage des économies.
Les États ont aussi maintenu des protections là où ils le souhaitaient, en particulier pour l’agriculture. C’était le seul moyen, pour les pays développés, de maintenir un secteur agricole viable dont l’importance (en termes d’harmonie sociale, de sécurité alimentaire, d’aménagement du territoire, d’identité culturelle) va bien au-delà du poids économique de ce secteur. Les produits culturels également sont exemptés des règles communes, comme l’a toujours souhaité la France.
De nouveaux outils
Par ailleurs, les pays se sont dotés d’instruments de défense commerciale pour pouvoir prendre des contre-mesures face aux cas de concurrence déloyale. Aux États-Unis, c’est la section 301 de 1974, complétée en 1988 (« super 301 »). L’Union européenne a des instruments comparables : on a à l’esprit l’interminable conflit commercial transatlantique sur les subventions à Airbus et Boeing, et c’est le fondement aujourd’hui des nouvelles taxes contre les produits chinois.
Beaucoup de domaines de la mondialisation sont peu régulés : les investissements, la finance, la fiscalité, la concurrence, l’environnement, le social. Libéraliser les échanges sans tenir compte des distorsions qui peuvent être créées dans d’autres domaines de l’activité économique revient à donner l’avantage aux moins-disants (ou aux moins-faisants). C’est pourquoi l’accent a de plus en plus été placé sur la « réciprocité » des échanges (en anglais « level playing field »). L’UE a ainsi adopté depuis plusieurs années des instruments pour contrôler les investissements étrangers, pour assurer la réciprocité de l’ouverture des marchés publics, ou réagir en cas de coercition économique, et sa « taxe carbone » (appelée « mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ») doit éviter que les efforts pour réduire les gaz à effet de serre dans la production en Europe soient annihilés par des biens importés.
Le tournant libéral des années 1980
Enfin, le libre-échange n’interdit pas de mener des politiques industrielles, qui passent par des aides d’État et relèvent donc de la politique de la concurrence (non régulée internationalement). Comme l’a montré Laurent Warlouzet, l’Europe voyait d’un œil favorable la politique industrielle jusqu’au tournant libéral des années 1980. Elle la redécouvre aujourd’hui à travers son concept d’autonomie stratégique « ouverte » entériné en 2020 pendant la pandémie de Covid-19. L’autonomie stratégique vise à réduire les dépendances et les vulnérabilités dans des secteurs clés de l’économie (agriculture, défense, énergie, espace, matières premières, numérique, santé, semi-conducteurs), mais elle se veut « ouverte » selon le souhait des pays nordiques. Elle passe par des projets industriels et par la diversification des approvisionnements, pas par l’autarcie ni le protectionnisme. Elle est aussi le miroir des politiques de la Chine (le plan « Made in China » de 2015) et des États-Unis (l’Inflation Reduction Act de 2021).
Tous ces éléments montrent que le libre-échange peut être encadré de manière à maintenir ses effets positifs sur les relations internationales et sur la prospérité générale tout en intégrant des paramètres géopolitiques, sociaux, environnementaux, et autres.
Forces et faiblesses du droit
Reste une dernière question qui est l’encadrement juridique du libre-échange. L’immense avancée, qui était un vrai changement de nature, a été la création de l’OMC en 1995, avec son mécanisme supranational de règlement des différends. Les guerres commerciales qui se livraient autrefois à coups de mesures et contre-mesures se réglaient désormais par un examen juridique et par la décision d’arbitres supranationaux. C’était une transformation capitale de la coopération internationale et une consolidation majeure du processus de mondialisation. Et c’était un changement de paradigme des États-Unis, qui avaient refusé de ratifier en 1948 la Charte de La Havane créant une organisation internationale du commerce, mais qui estimaient après la guerre froide que le droit et la mondialisation servaient leurs intérêts.
Or l’Organe de règlement des différends est en crise du fait de la décision de l’administration Trump (premier mandat) de ne plus nommer d’arbitres. Cela reflète le tournant protectionniste des États-Unis, à la fois pour enrayer la montée de la Chine en voie de dépasser les États-Unis, et aussi pour des raisons politiques et sociales. L’administration Biden n’a pas remis en question ce tournant, qui nous ramène à l’époque des rapports de force commerciaux et nous éloigne d’un « ordre multilatéral fondé sur des règles », comme le souhaite encore l’Union européenne.
Cela nous éloigne de l’objectif d’un monde plus pacifique uni par le droit, ce que l’on ne peut que regretter. Mais cela reflète la réalité d’un monde géopolitiquement plus fragmenté, mû par les rapports de puissance. À court et moyen terme, il faut prendre acte de cette réalité, préserver ce qui peut l’être du libre-échange et de la mondialisation, et se donner les moyens d’encadrer les échanges au mieux de nos intérêts. Et l’Union européenne, malgré ses contraintes, offre aux pays qui en sont membres un bouclier protecteur et une puissance accrue pour défendre leurs intérêts en commun.![]()
Maxime Lefebvre ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.








![[TRIBUNE] Police : une désorganisation qui sacrifie la sécurité des Français](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2024/07/2048px-Police-IMG_4105-616x411.jpg?#)








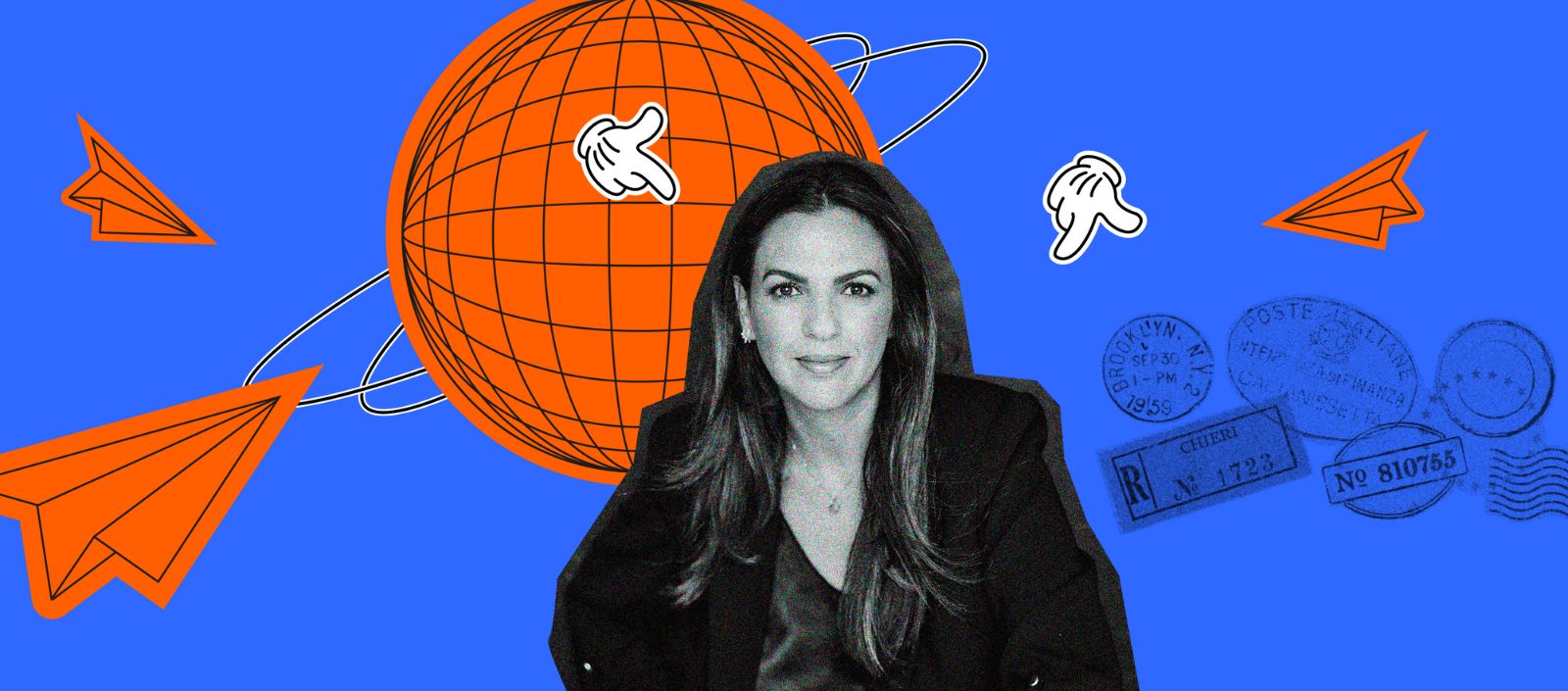


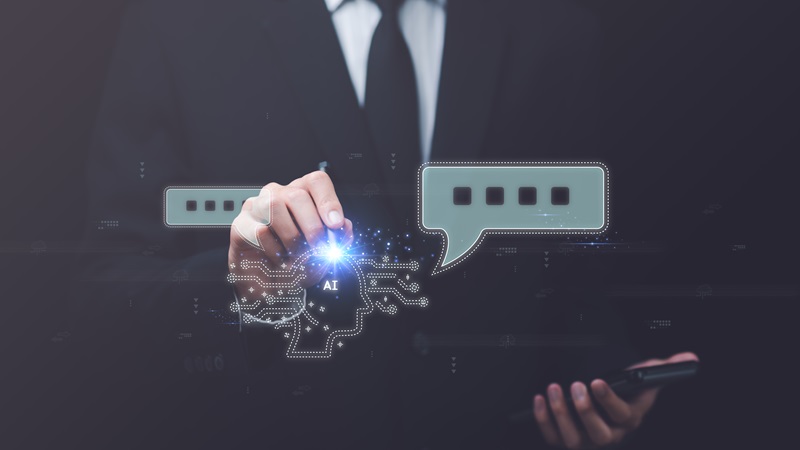


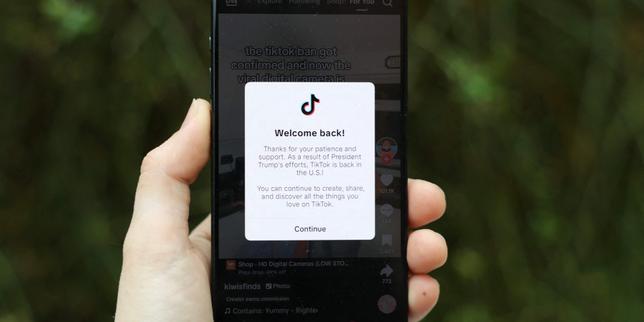






.jpg)










































