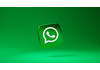“Nosferatu”, de l’origine du mal vue par Murnau au désir chez Robert Eggers
“Nosferatu”, de l’origine du mal vue par Murnau au désir chez Robert Eggers nfoiry dim 19/01/2025 - 10:00 En savoir plus sur “Nosferatu”, de l’origine du mal vue par Murnau au désir chez Robert Eggers Du chef-d'œuvre expressionniste de F. W. Murnau en 1922 à la version contemporaine de Robert Eggers en 2024, en passant par la relecture révolutionnaire de Werner Herzog en 1979, chaque adaptation de Nosferatu, propose sa propre déclinaison du monstre qui travaille son époque – le mal, le désir, la révolution. Séance de cinéma guidée (attention, divulgâchis !). [CTA2]Il fallait du courage pour s’attaquer à un monstre sacré comme Nosferatu. En 1922, F. W. Murnau avait adapté, en le simplifiant, le roman de l’Anglais Bram Stoker, Dracula, dont il n’avait pas les droits. Le film, considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre du cinéma et véritable pièce maîtresse de l’expressionnisme allemand des années 1920, est difficile à égaler. Jusqu’à il y a peu, le dernier à en proposer une réinterprétation était le cinéaste allemand Werner Herzog, en 1979, soit plus d’un demi-siècle après l’œuvre originale. En 2024, ce n’est plus un Allemand mais la coqueluche du cinéma indépendant américain, Robert Eggers, qui s’y colle. Chacun des films suit la même trame narrative : l’histoire débute dans une petite bourgade allemande, où un clerc de notaire (Hutter ou Harker) fraîchement marié à une belle jeune femme (Ellen ou Lucy) est envoyé au fin fond de la Transylvanie par son patron pour vendre une propriété au mystérieux et richissime comte Orlock, qui désire avoir une résidence en ville. Bien sûr, ce comte n’est autre qu’un vampire qui souhaite mettre main basse sur la jeune mariée, et qui neutralise donc le héros empressé avant de débarquer dans la bourgade. Murnau ou l’origine du mal À son mari Hutter, souriant, qui lui offre un bouquet de fleurs dans une démonstration policée de dévotion conjugale, Ellen répond : « Pourquoi les as-tu tuées? Ces jolies fleurs… ». C’est là le thème central du film de Murnau, tourné quatre ans après la Première Guerre mondiale dans une Allemagne exsangue et traumatisée par ses pertes. Le plus grand des raffinement, le plus beau des ordres ne naissent-ils pas de crimes, de pulsions destructrices, de forces opaques ? Après tout, le beau bouquet n’existe que parce que l’homme en a arraché les fleurs. “Murnau met en scène la gestion collective de ce mal, au delà de son expérience intime”En cela, le film est dans la droite ligne du « romantisme noir » du XIXe siècle, qui a connu Dracula, Jack L’Éventreur et autre créature de Frankenstein : sous des apparences civilisées sommeillent des désirs incontrôlables, refoulés, mal assouvis, remontant à la surface nous hanter sous forme de monstres. La forme est toute entière mise au service de cet ébranlement : en même temps que vacillent la civilisation européenne et sa réalité bien encadrée par la science et la raison, le film se charge d’effets spéciaux, d’éclairage contrastés, de distorsions des visages et des arbres… Autant de manières de rendre la nausée d’un mal qui menace de prendre possession de l’humain. Il faudra le sacrifice volontaire d’une jeune femme innocente, Ellen, pour que le monstre s'oublie et finisse par disparaître. Mais Murnau met également en scène la gestion collective de ce mal, au delà de son expérience intime. L’arrivée du comte Orlock dans la ville tranquille où il entend bien se repaître du sang de la belle Ellen, se double de l’arrivée d’un fléau, la peste – représentée par des rats, embarqués dans des cercueils pleins de terre que le comte transporte sur le bateau entre la Transylvanie et l’Allemagne. Cortèges de cercueils qui descendent les rues, croix blanches sur les maisons des malades, cadavres jonchant le sol… La ville entière est en deuil. Tout au long du film, les différentes institutions chargées de réguler la société sont mises en échec : les douaniers qui inspectent la cargaison du navire ne comprennent pas à qui ils ont affaire et laissent passer le vampire et son drôle de chargement ; le gardien de la prison où est enfermé le serviteur et intermédiaire du comte Orlock, Herr Knock, est neutralisé ; les médecins respectables qui se chargent d’examiner la pauvre Ellen font chou blanc devant ses crises de somnambulisme inexplicables. Là où arrive le vampire, l'ordre chancelle. Herzog ou le vampire révolutionnaireCet aspect révolutionnaire est peut-être ce qui plaira plus tard à Werner Herzog. « Nosferatu n'est pas un monstre, avoue-t-il dans une interview au New York Times, c’est une force de changement ambivalente et magistrale. Lorsque la peste menace, les gens jettent leurs biens à la rue, ils se débarrassent de leurs atours bourgeois. On assiste à une réévaluation de la vie et de son sens. » Le film se moque explicitement des notables de province. Les « savants » en haut-de-forme se carapatent sitôt que le mot « peste » est prononcé ; les nantis font un banquet au milieu des rats qui

Du chef-d'œuvre expressionniste de F. W. Murnau en 1922 à la version contemporaine de Robert Eggers en 2024, en passant par la relecture révolutionnaire de Werner Herzog en 1979, chaque adaptation de Nosferatu, propose sa propre déclinaison du monstre qui travaille son époque – le mal, le désir, la révolution. Séance de cinéma guidée (attention, divulgâchis !).
[CTA2]
Il fallait du courage pour s’attaquer à un monstre sacré comme Nosferatu. En 1922, F. W. Murnau avait adapté, en le simplifiant, le roman de l’Anglais Bram Stoker, Dracula, dont il n’avait pas les droits. Le film, considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre du cinéma et véritable pièce maîtresse de l’expressionnisme allemand des années 1920, est difficile à égaler. Jusqu’à il y a peu, le dernier à en proposer une réinterprétation était le cinéaste allemand Werner Herzog, en 1979, soit plus d’un demi-siècle après l’œuvre originale. En 2024, ce n’est plus un Allemand mais la coqueluche du cinéma indépendant américain, Robert Eggers, qui s’y colle.
Chacun des films suit la même trame narrative : l’histoire débute dans une petite bourgade allemande, où un clerc de notaire (Hutter ou Harker) fraîchement marié à une belle jeune femme (Ellen ou Lucy) est envoyé au fin fond de la Transylvanie par son patron pour vendre une propriété au mystérieux et richissime comte Orlock, qui désire avoir une résidence en ville. Bien sûr, ce comte n’est autre qu’un vampire qui souhaite mettre main basse sur la jeune mariée, et qui neutralise donc le héros empressé avant de débarquer dans la bourgade.
Murnau ou l’origine du mal
À son mari Hutter, souriant, qui lui offre un bouquet de fleurs dans une démonstration policée de dévotion conjugale, Ellen répond : « Pourquoi les as-tu tuées? Ces jolies fleurs… ». C’est là le thème central du film de Murnau, tourné quatre ans après la Première Guerre mondiale dans une Allemagne exsangue et traumatisée par ses pertes. Le plus grand des raffinement, le plus beau des ordres ne naissent-ils pas de crimes, de pulsions destructrices, de forces opaques ? Après tout, le beau bouquet n’existe que parce que l’homme en a arraché les fleurs.
“Murnau met en scène la gestion collective de ce mal, au delà de son expérience intime”
En cela, le film est dans la droite ligne du « romantisme noir » du XIXe siècle, qui a connu Dracula, Jack L’Éventreur et autre créature de Frankenstein : sous des apparences civilisées sommeillent des désirs incontrôlables, refoulés, mal assouvis, remontant à la surface nous hanter sous forme de monstres. La forme est toute entière mise au service de cet ébranlement : en même temps que vacillent la civilisation européenne et sa réalité bien encadrée par la science et la raison, le film se charge d’effets spéciaux, d’éclairage contrastés, de distorsions des visages et des arbres… Autant de manières de rendre la nausée d’un mal qui menace de prendre possession de l’humain. Il faudra le sacrifice volontaire d’une jeune femme innocente, Ellen, pour que le monstre s'oublie et finisse par disparaître.
Mais Murnau met également en scène la gestion collective de ce mal, au delà de son expérience intime. L’arrivée du comte Orlock dans la ville tranquille où il entend bien se repaître du sang de la belle Ellen, se double de l’arrivée d’un fléau, la peste – représentée par des rats, embarqués dans des cercueils pleins de terre que le comte transporte sur le bateau entre la Transylvanie et l’Allemagne. Cortèges de cercueils qui descendent les rues, croix blanches sur les maisons des malades, cadavres jonchant le sol… La ville entière est en deuil.
Tout au long du film, les différentes institutions chargées de réguler la société sont mises en échec : les douaniers qui inspectent la cargaison du navire ne comprennent pas à qui ils ont affaire et laissent passer le vampire et son drôle de chargement ; le gardien de la prison où est enfermé le serviteur et intermédiaire du comte Orlock, Herr Knock, est neutralisé ; les médecins respectables qui se chargent d’examiner la pauvre Ellen font chou blanc devant ses crises de somnambulisme inexplicables. Là où arrive le vampire, l'ordre chancelle.
Herzog ou le vampire révolutionnaire
Cet aspect révolutionnaire est peut-être ce qui plaira plus tard à Werner Herzog. « Nosferatu n'est pas un monstre, avoue-t-il dans une interview au New York Times, c’est une force de changement ambivalente et magistrale. Lorsque la peste menace, les gens jettent leurs biens à la rue, ils se débarrassent de leurs atours bourgeois. On assiste à une réévaluation de la vie et de son sens. » Le film se moque explicitement des notables de province. Les « savants » en haut-de-forme se carapatent sitôt que le mot « peste » est prononcé ; les nantis font un banquet au milieu des rats qui grouillent ; à la fin du film, un policier arrête le médecin courageux qui a osé parachever le sacrifice de Lucy en plantant un pieux dans le cœur du vampire pour le tuer une fois pour toutes, et demande à ce qu’on l’emmène en prison pour « meurtre ». À chaque fois, le vrai danger est ignoré, mal compris, et finira par frapper plus tard.
“Dans une Allemagne en prise avec son passé nazi, Herzog met en scène une société incapable de comprendre le mal qui la ronge et reproduit les mêmes erreurs que ses pères”
Lucy, jouée par Isabelle Adjani, est la seule qui échappe à la cécité : yeux exorbités, peau blanche comme le vampire de Murnau, elle se débat dans un monde où personne ne la croit. Conscience révolutionnaire, elle comprend seule ce qu’il lui reste à faire pour débarrasser la ville d’Orlock et de la maladie – alors que le reste de la population, aveugle et sourde, continue de tourner à vide dans un monde qui s’effondre. Trente-cinq ans après la guerre, dans une Allemagne en prise avec son passé nazi, Herzog met en scène une société incapable de comprendre le mal qui la ronge et reproduit les mêmes erreurs que ses pères. Ce qui explique la fin du film, qui diffère radicalement de la version de Murnau : le comte meurt mais le vampire ne meurt pas : Lucy, s’est sacrifiée pour rien, car son mari a été mordu, l’a oubliée, et s’enfuit à cheval pour continuer l’œuvre de son prédécesseur.
Enfin, passage au cinéma parlant oblige, Herzog est celui qui donne au comte Orlock une voix et une respiration saccadée et inquiète. Ce qui n’était qu'une silhouette cauchemardesque chez Murnau est soudain dotée d’un souffle, anima, donc d’une âme. Capable de parler en son nom, le personnage incarné par Klaus Kinski prend une autre dimension. Voix sifflante et plaintive, yeux humides et rougis, il devient un être pathétique, rendu monstrueux par sa solitude centenaire. Lui qui souhaiterait mettre fin à ses supplices ne peut pas mourir : il sème la mort alors qu’il veut désespérément être aimé.
Le thème du désir sexuel inassouvi apparaît ici plus clairement que dans la version de Murnau, notamment à travers la relation qu’entretient le vampire avec la jeune Lucy. Si dans la version de 1922, Orlok hantait la jeune mariée dans ses rêves par son ombre projetée sur le mur, ici la poursuite prend chair : il la suit dans sa salle de bain, elle part à sa poursuite dans son manoir. La deuxième moitié du film met en scène la lente préparation d’une rencontre qui sera à la fois mortelle et érotique. « Il y a une scène où il lui suce le sang, raconte Klaus Kinski au New York Times, il suce encore et encore comme un animal, et soudain le visage [d’Isabelle Adjani] prend une expression nouvelle, une expression sexuelle : elle ne le laissera plus s'éloigner. Un désir est né. »
Eggers ou le désir aux mains propres
En 2024, Robert Eggers entend faire de ce thème du désir féminin la pièce maîtresse de son remake. Herzog mettait en scène un vampire en mal d’amour, malheureux dans sa solitude et malade de désir ; chez Robert Eggers, le film s’ouvre sur un flashback où l’on voit Ellen, encore jeune, qui erre en petite tenue dans un grand jardin et implore un peu de compagnie. Manque de chance pour elle : elle réveille le comte Orlock, qui s’empare d’elle et l’entraîne dans des convulsions mi-extatiques, mi-épileptiques. Le dispositif est assez clair, le mystère du lien entre le vampire et la jeune femme est définitivement élucidé : le désir sexuel de la jeune femme et la honte qu’elle ressent ont éveillé un monstre qui sème destruction et terreur sur son passage. Du désir, il ne reste que la destruction ou la rédemption par l’union finale, « consentie »… une morale au fond pas très révolutionnaire.
“Robert Eggers place le curseur du côté de la sexualité dans ce qu’elle a d’intime, et interroge la prise que l’on peut avoir sur ses propres désirs cachés”
En 2024, Nosferatu ne questionne pas réellement la part obscure de la civilisation, comme l’avait fait Murnau ; il ne traite pas non plus la révolution de l’ordre bourgeois, comme Herzog. Robert Eggers place le curseur du côté de la sexualité dans ce qu’elle a d’intime, et interroge la prise que l’on peut avoir sur ses propres désirs cachés. Mais là où le film muet laissait de la place à l’imagination et à l’ambiguïté, la version actuelle est plus directive : nulle zone d’ombre, nulle ambiguïté. Là où la couleur et le son étaient mis au service, chez Herzog, de choix narratifs, ils sont ici à la fois omniprésents et sous-exploités : teintes, décors et costumes, parfaitement assortis dans les tons de gris-taupe, reproduisent un imaginaire gothique maniéré. Pour un film sur le désir, il est bizarrement propre.
S’ajoute donc à la contrainte du récit initial, la contrainte du genre horrifique : en effet, entre Murnau et Eggers, il y a un siècle de films de ce genre ! Le réalisateur américain doit donc composer avec une grammaire de la terreur réglée comme du papier à musique. La voix du comte Orlock est asthmatique et rauque, comme une sorte de Darth Vador sous stéroïdes. Son corps est l’objet d’un suspense inutile : chez Murnau le face-à-face était très rapide – le vampire venait lui-même chercher le jeune clerc perdu dans la montagne pour l’amener à son château. Ses yeux éternellement écarquillés et expressifs, presque comiques, nous poursuivaient pendant tout le film. À l’inverse, chez Eggers la silhouette et le visage du comte perdent leur part humaine, en faisant un « méchant » en bonne et due forme : maquillé comme un mort-vivant, il se dérobe à la caméra et reste dans l’ombre pour ménager l’effet de dégoût. Effaçant du même coup cette quasi-humanité du vampire qui le rendait si dérangeant. janvier 2025










![[LE GÉNIE FRANÇAIS] Le paquebot France, un géant des mers](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/france-paquebot-616x347.jpg?#)
![[CINÉMA] Totto-Chan, pour ravir notre jeune public](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/totto-chan-616x350.png?#)